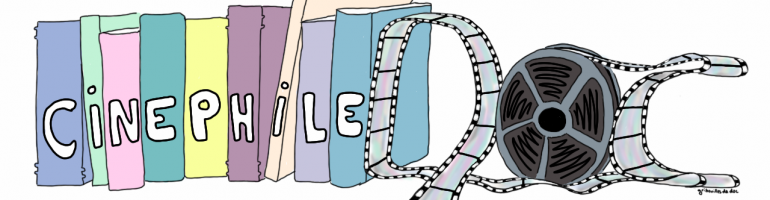Voici le premier compte-rendu de lecture de la rentrée, qui arrive assez tôt, puisqu’il s’agit d’un livre paru au mois d’août, et que je garde un deuxième compte-rendu en réserve pour fin septembre ou début octobre.
Pour le titre de cet article, j’ai quelque peu hésité : il aurait pu s’appeler, en référence à l’auteur du livre « La Femme qui aimait Maurice Jaubert » (référence également truffaldienne) mais cela m’a paru quelque peu excessif… et pourtant… j’y reviendrai.
Finalement je me suis décidée pour ce « À la recherche… » car ce livre, que je nommerai dans quelques lignes, tout en allers et en retours, tout en nostalgie et en sensations, avait quelque chose de proustien.
Truffaldien et proustien, ça y est les deux termes sont posés, ceux qui me connaissent bien savent que l’ouvrage dont je vais parler m’a plu.
Parfums, promenades et musiques
Le livre en question est un roman publié par Maryline Desbiolles aux éditions du Seuil, collection Fiction & Cie, Le Beau temps. Comme j’avais déjà trouvé il y a quelques jours, un livre consacré au cinéma dont faire le compte-rendu pour le mois de septembre, je n’avais pas prévu d’acheter ce livre…
Mais le premier ouvrage ne devant sortir que dans une semaine, j’ai découvert en me promenant dans le rayon fictions de ma librairie, ce roman qui se trouvait parler surtout d’un homme, beaucoup de musique, mais aussi de cinéma, et dont je ne connaissais absolument pas l’auteure.
C’est en lisant une par une les quatrièmes de couverture des nouveautés que mon attention s’est fixé sur Le Beau temps. Il y avait aussi un autre livre, dont j’ai perdu le titre, mais la lecture – déterminante – des quelques premières lignes ne m’a pas vraiment emballée. Celles du Beau temps, au contraire, m’ont saisie :
L’Ariane est une donneuse. L’Ariane, la banlieue à l’est de Nice, est une donneuse de noms. Ariane en tout premier. Ariane, Maurice Jaubert. Maurice Jaubert est le nom du collège de l’Ariane où je suis invitée pour parler avec les élèves d’un de mes livres qui met leur quartier en scène.
Passées ces quelques lignes, je me dis : un livre qui s’ouvre par la visite d’un collège… J’hésite, puis je poursuis, car je pense en moi-même que l’auteure rêve sur les noms et sur les lieux – une onomastique, en somme – et déjà je pense à Proust et à son « Nom de pays : le Nom »…
Sa visite la fait s’interroger sur Maurice Jaubert, tout comme je me suis demandée moi-même souvent qui sont les Maryse Bastié, Corentin Celton, Paul Bert ou encore Edgar Quinet en voyant leur nom dans les rues et les stations de métro.
Mais c’est en revoyant La Chambre verte de Truffaut que sa curiosité va plus loin, Jaubert occupant dans ce film une place prépondérante.
Qui est Maurice Jaubert ?
Dans La Chambre verte, une photographie, une époque et surtout une musique.
La photographie, c’est celle-ci :
Elle apparaît dans la chapelle des morts imaginée par Julien Davenne, le héros du film incarné par Truffaut lui-même, un homme veuf, rescapé de la Grande guerre, qui préfère se consacrer au culte de ses chers disparus que vivre parmi les vivants.
Dans cette chapelle, Truffaut a fait figurer les hommes, vivants ou morts, qu’il admirait : Cocteau, Proust, Henry James, et donc, Maurice Jaubert.
Dans la scène ci-dessus, la chapelle restaurée de Davenne s’offre pour la première fois au regard du spectateur, avec, évidemment la musique de Maurice Jaubert.
La musique de ce dernier apparaît dans trois autres films de Truffaut : L’Histoire d’Adèle H., L’Argent de poche et L’Homme qui aimait les femmes.
Mais au moment où Truffaut utilise la musique de ce compositeur, celui-ci est mort depuis plus d’une trentaine d’années, victime malheureuse de la drôle de guerre, et même disparu d’une manière injustement idiote trois jours avant l’armistice signé par Pétain, le 19 juin 1940.
C’est donc à travers les films de Truffaut que Jaubert est connu aujourd’hui, mais aussi par son travail avec certains des plus grands cinéastes français de l’entre-deux-guerres : Jean Vigo, René Clair et Marcel Carné.
Pour Jean Vigo, il a notamment écrit la musique de l’Atalante et de Zéro de conduite :
Pour Marcel Carné, il compose la musique de Drôle de drame, Quai des brumes, Le Jour se lève et Hôtel du Nord :
(Je ne mets pas forcément ces films dans l’ordre chronologique, j’ai simplement fait la part belle à ceux que je préférais).
Je dois avouer que, pour moi, Maurice Jaubert est resté longtemps indéfectiblement lié à Truffaut. Je le savais compositeur et disparu en 1940, mais je n’avais pas fait le rapprochement entre Carné, Jouvet, Arletty, Hôtel du Nord – pour ne citer qu’eux – et Maurice Jaubert.
Je rêvais d’ailleurs sur les noms moi aussi, les titres des films de Carné étant pour moi des expressions en trois mots, avec une poétique bien particulière à faire résonner : Drôle de drame, Hôtel du Nord, Quai des brumes, visiteurs du soir, enfants du paradis (j’ôte le déterminant à dessein). Et je rêvais sur les visages : celui de Jouvet aux sourcils froncés, celui de Michèle Morgan transfigurée dans Quai des brumes, celui d’un Jean-Pierre Aumont espiègle dans l’un et fiévreux dans l’autre…
Bien-sûr, j’ai une petite préférence pour Les Enfants du paradis, fresque sur les arts du spectacle, dont Jaubert n’a pas pu composer la musique, à laquelle j’avais déjà consacré un article, et dont de temps en temps, quelques répliques me reviennent en mémoire :
« Vous êtes trop fier Pierre-François, il faut rentrer en vous-même ». Alors je suis rentré en moi-même… Les imprudents ! Me laisser seul avec moi-même et ils me défendaient les mauvaises fréquentations !
Ou encore…
Paris est tout petit pour ceux qui s’aiment, comme nous, d’un aussi grand amour.
Je revois Arletty descendre le boulevard du crime, tout comme je peux revoir Jouvet caresser sa fourchette dans Drôle de drame, en répétant « Bizarre, bizarre… », Michel Simon chanter « Dormez, dormez, petits moutons », et Michèle Morgan demander à Gabin de l’embrasser. Tout comme je peux aussi revoir, chez Renoir, Pierre Fresnay jouer de la flûte dans La Grande illusion, ou Paul Meurisse sortir de la baignoire des Diaboliques de Henri-Georges Clouzot… il y a des choses qu’on a du mal à oublier.
Mais revenons-en à Maurice Jaubert, et plus précisément, au Beau temps de Maryline Desbiolles.
Mesures d’une vie ensoleillée
Si j’ai hésité à donner comme titre à mon article « La Femme qui aimait Jaubert » – en référence à L’Homme qui aimait les femmes – c’est parce que de la première à la dernière page, ce dont le lecteur fait l’expérience, c’est une rencontre amoureuse qui a eu lieu et n’a pas eu lieu.
Elle a eu lieu car nous y assistons, nous la voyons prendre forme et vie au fil des pages, à mesure que l’auteure explore et nous raconte la brève existence de Maurice Jaubert, qui prend plusieurs visages : Niçois, fils aimé, élève trop bon élève, amateur d’alpinisme et de voitures, étudiant en droit, soldat, musicien autodidacte devenu compositeur, intellectuel, époux et père de famille, mort pour la France… j’en oublie certainement.
Elle n’a pas eu lieu parce qu’elle reste un rendez-vous manqué, avec une figure immortelle et immortalisée mais absente, disparue, une photographie dans la chapelle des morts de La Chambre verte, où pour Maryline Desbiolles, il n’y aurait que les portraits de Jaubert, de sa naissance à sa disparition.
L’auteure n’est pas une spécialiste de musique : elle le dit elle-même, elle sait à peine lire les partitions, qui lui font l’effet d’un langage mystérieux et d’autant plus irrésistible. Elle s’attache davantage à l’homme derrière la partition, dont elle guette les moindres mouvements passés comme s’ils allaient encore advenir.
Elle suit Jaubert à la trace comme on se lancerait dans une filature. Elle nous en restitue la voix, que nous pouvons presque entendre, les mouvements, que nous pouvons presque sentir, et le regard, que nous pouvons presque croiser.
Ainsi, entre allers et retours, entre enfance et maturité, Maurice Jaubert n’est-il pas seulement compositeur de musiques des films que nous avons vus et revus, il devient à part entière un personnage de cinéma – d’une usine à rêves dans laquelle tantôt il s’éloigne, tantôt il se rapproche, flashbacks, gros plans, ralentis et arrêts sur image.
Arrêts sur image au milieu d’une promenade, qui passe par Nice, principalement, au passé (celui de l’auteur et celui de Jaubert) mais aussi au présent, par Paris, par le sud et la Provence, par l’Angleterre, par l’est fatal enfin.
Une page surtout m’a beaucoup plu, dans ce livre imprégné de poésie, de nostalgie et de tendresse :
Je regarde de nouveau À propos de Nice. Il est dit que Maurice Jaubert n’a pas rencontré Jean Vigo avant 1932. On m’a pourtant raconté que Maurice et son frère René auraient figuré dans À propos de Nice tourné en 1930. (…) je crois reconnaître Maurice parmi les endormis de la promenade des Anglais, alangui sur une chaise, la figure posée sur sa main, la bouche entrouverte, le chapeau sur les genoux. Ce n’est sûrement pas lui, mais soudain l’innocente sieste m’annonce le dormeur du val de 1940, le dormeur soustrait au soleil du Midi, soustrait à la mer, le dormeur des futaies, de la mousse, des intermittences de la lumière, de l’ombre, il aura deux trous rouges au côté droit, son visage s’enfoncera dans la paume des bois, des Hauts Bois d’Azerailles dont la sonorité même est l’envers de Nice, de son unique syllabe, brillante, aérienne.
Les références poétiques, musicales et cinématographiques fourmillent dans ce roman, on y croise non seulement Carné et Vigo, mais aussi Ravel et Jean Giono, on s’y souvient de Rimbaud et de Proust, en attendant Truffaut.
L’auteur y mêle ses souvenirs à ceux de Maurice Jaubert, sa vie à la sienne, et partageant cette relation rêvée et privilégiée – elle nous y convie, nous amène à littéralement à vivre avec lui, avec elle – elle ne fait pas seulement de nous des spectateurs, ou les lecteurs attentifs d’une partition, mais le témoin indispensable de son amour en fuite.