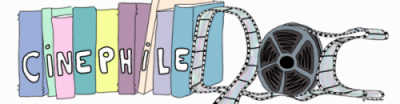Ayant été pas mal accaparée à nouveau par ce sujet qui n’en finit pas de m’intéresser, je vous propose un cinquième épisode (et certainement un sixième très prochainement) de mes notes de lecture sur l’intelligence artificielle.
J’y ferai la recension d’au moins trois ouvrages (publications datant de 2023) et quelques extraits d’un quatrième, de différents articles de presse (2023 et 2024) ainsi qu’un retour d’expérience sur un outil d’intelligence artificielle testé dans le cadre de l’élaboration d’un scénario pédagogique.
Pour ces deux articles successifs, j’aborde deux angles d’approche, ce qui va me permettre de répartir les sources :
- Le premier de ces angles est la relation entre intelligence artificielle et questionnements climatiques ;
- Le second s’intéressera plus précisément aux outils d’intelligence artificielle générative, en particulier Chat GPT, tout en mettant l’accent sur des aspects sociaux, politiques et historiques.
Pour ces deux articles, je garderai la même structure que les notes de lecture précédentes.
Dans cet épisode :
- les ouvrages Le Département des théories fumeuses, de Tom Gauld et Intelligence artificielle, de Julie Lardon et Agathe Robinson-Deroo
- revue de presse d’articles disponibles en ligne sur la thématique intelligence artificielle et climat
- sélection de ressources autour de l’outil Climate Q&A
Le Département des théories fumeuses, de Tom Gauld
Pour commencer cet article avec humour et sous l’angle à la fois du dessin et de la vulgarisation scientifique, je voulais évoquer rapidement cette lecture très récréative, que je dois à l’une de mes amies professeures documentalistes.
J’avais déjà dans ma bibliothèque les ouvrages brillants de Tom Gauld, qui sont fabuleux de drôlerie et de culture : En cuisine avec Kafka et La Revanche des bibliothécaires.

Si je retiens aussi Tom Gauld dans mes notes de lecture sur l’intelligence artificielle, c’est parce que dans ce nouvel ouvrage, Le Département des théories fumeuses, quelques planches permettent d’en illustrer certains aspects.
Je me permets d’en glisser ici deux petits exemples :
Je vous invite fortement à découvrir tous ces ouvrages qui sont magnifiques et également à suivre son compte Instagram.
Intelligence artificielle, de Julie Lardon et Agathe Robinson-Deroo

Cet ouvrage de vulgarisation est l’un des plus récents paru sur le sujet, et c’est également l’un des derniers ouvrages que j’ai reçus au CDI sur la question.
Ce document compte moins d’une centaine de pages, et propose un aperçu accessible et synthétique.
Dans une première partie « L’homme et la machine« , les auteures dressent un panorama historique de l’intelligence artificielle :
- les premiers ordinateurs avec la figure d’Ada Lovelace
- Alan Turing, la machine de Turing, le jeu de l’imitation et le test de Turing
- la conférence de Dartmouth et le Perceptron de Frank Rosenblatt, dont le fonctionnement tente d’imiter celui de la pensée humaine, ce qui servira de modèle aux systèmes experts
- le logiciel Eliza, premier à tenir une conversation avec un humain
- les différentes évolutions : apprentissage automatique (machine learning), apprentissage supervisé, apprentissage par renforcement et apprentissage profond (deep learning)
Le fonctionnement de l’apprentissage automatique est expliqué de manière illustrée
La partie qui m’a le plus intéressée dans ce chapitre est celle de l’entrainement par les jeux, où les auteures proposent une chronologie qui relie les jeux et les évolutions de l’intelligence artificielle, avec différents programmes d’échecs, de dames et de morpion élaborés depuis 1948, jusqu’à Pluribus développé par des ingénieurs de Carnegie-Mellon et capable de bluffer au poker, en passant par Deep Blue et AlphaGo.
Cette partie revient également sur l’utilisation de GTA V pour entraîner des logiciels de voitures autonomes.
Enfin une double-page dresse un aperçu des acteurs de l’intelligence artificielle : entreprises (IBM, DeepMind, Amazon, Facebook), États et instituts de recherche.
Dans la deuxième partie, « Une technologie en plein essor« , l’ouvrage revient sur les fonctionnalités les plus récentes de l’intelligence artificielle :
- reconnaissance d’images (surveillance, reconnaissance faciale, santé et industrie)
- traitement du langage (chatbots, traduction automatique, reconnaissance vocale et modération)
- analyse de données (systèmes de recommandations, voitures autonomes, logiciels de prédiction) jusqu’aux villes intelligentes
- robotique
Enfin la troisième partie, « Vers une société « intelligente » ? » ouvre le débat en revenant sur différents aspects de l’intelligence artificielle à remettre en perspective…
D’un côté les points de vigilance :
- les biais algorithmiques des intelligences artificielles (avec l’exemple de Tay lancé en 2016 par Microsoft)
- la question de la surveillance et de l’utilisation des données personnelles (et le score social chinois)
- la manipulation et la désinformation avec un accent mis sur les deepfake
- les questionnements éthiques (encart Lois de la robotique)
De l’autre les bénéfices :
- lutte contre la pauvreté
- santé
- anticipation du changement climatique
Ce dernier point est abordé très rapidement et revient sur le dilemme consommation d’énergie par les outils d’intelligence artificielle VS établissement de modèles pour prévoir les événements climatiques.
Mon avis sur l’ouvrage
C’est un petit ouvrage très accessible, illustré agréablement et qui revient d’une manière synthétique et rapide sur les différents enjeux de l’intelligence artificielle. Il permet un premier aperçu ou de réactiver (pour ma part) assez succinctement des connaissances sur la question.
Climat et IA : revue de presse
Comme je l’ai indiqué dans mon précédent article #profdoc, j’ai proposé dans le cadre de la semaine de la presse une séance « Presse et Climat » à un groupe de terminale HGGSP, à la demande de mon collègue en charge de l’enseignement.
Pour l’occasion, j’ai élaboré pour les élèves différents ateliers, et un peu tardivement, j’ai eu l’idée de leur proposer également une activité « intelligence artificielle et climat ».
J’ai donc été amenée à consulter un certain nombre de ressources sur la question et c’est aussi pour cette raison que les dernières pages de l’ouvrage présenté plus haut ont retenu mon attention.
Pour cette revue de presse, je propose donc une sélection d’articles issus non pas des abonnements papiers du CDI comme à l’accoutumée, mais issus de ma veille sur la question.
« Une IA a illustré le rapport du GIEC et le résultat est sombre ». L’ADN, 6 avril 2023, https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/changements-climatiques-illustration-rapport-intelligence-artificielle-midjourney/
L’article publié en avril 2023 met l’accent sur la façon dont l’intelligence artificielle peut sensibiliser au changement climatique, en prenant comme point de départ une présentation du réchauffement climatique proposé en 2018 par le climatologue Ed Hawkins.
Il explique comment le professeur Aurélien Saussay a utilisé l’outil Midjourney pour réaliser des visuels sur les titres du dernier rapport du GIEC.
Sont ainsi illustrés les phénomènes météorologiques extrêmes, les flux financiers et les adaptations au changement climatique, les risques, la menace pour le bien-être humain.
L’IA pour lutter contre le changement climatique et favoriser la durabilité environnementale | Inria. 6 juillet 2023, https://www.inria.fr/fr/ia-changement-climatique-environnement.
Dans cet article mis à jour en 2024, l’INRIA revient sur la mise en place d’une équipe en son sein par la chercheuse Claire Monteleoni pour prédire l’évolution du climat et anticiper les phénomènes extrêmes.
Cette équipe doit relever le défi des données à traiter pour répondre aux questions climatiques, des données qui restent complexes à manipuler (données massives à exploiter dans certaines zones, données manquantes pour d’autres régions).
L’intelligence artificielle peut aider à combler les données manquantes mais aussi à prendre des décisions, et l’apprentissage automatique peut aider à répondre à ces problématiques.
Le projet ARCHES entend ainsi optimiser l’intelligence artificielle pour lutter contre le changement climatique à travers trois axes de recherche :
- L’IA pour la science du climat : pour améliorer la compréhension scientifique de l’évolution du système climatique.
- L’IA pour l’adaptation au changement climatique : pour concevoir l’impact social et accompagner les communautés et les décideurs avec des outils d’aide à la prise de décision.
- L’IA pour l’atténuation du changement climatique : pour accélérer notre transition écologique, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables.
Mettre l’intelligence artificielle au service de l’action climatique dans les pays en développement, voici le défi lancé à la COP 28, Communiqué ONU Changement climatique, 9 décembre 2023
Ce communiqué publié sur le site de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 28) revient sur les différentes déclarations des participants qui mettent en relation climat et intelligence artificielle.
À retenir, ce paragraphe en particulier :
L’événement de la COP 28 a réuni des dirigeants de gouvernements, des Nations unies, d’agences de coopération au développement et d’entreprises pour discuter de la manière dont l’IA peut être utilisée pour une action climatique transformationnelle dans les nations en développement, tout en veillant à ce qu’elle ne contribue pas à élargir la fracture numérique causée par l’inégalité de l’accès à la technologie.
« Intelligence artificielle bonne ou mauvaise idée pour la planète ? » France Inter, 12 avril 2023, https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-mercredi-12-avril-2023-7653937.
Enfin dans cette dernière ressource (une émission de France Inter que j’avoue ne pas avoir eu le temps d’écouter jusqu’au bout), l’article associé à cette émission revient sur les différents points de débat autour de l’intelligence artificielle et des questionnements climatiques, déjà relevés dans l’article de l’INRIA :
- le traitement des données complexes par l’IA et les modélisations climatiques
- une prédiction plus rapide et efficace des évolutions climatiques
- mais des technologies elles-mêmes énergivores, avec un poids carbone de plus en plus important
Néanmoins la principale ressource qui revenait dans mes recherches pour faire le lien entre intelligence artificielle et questionnements climatiques était justement un outil d’intelligence artificielle proposé afin d’étudier les différents rapports du GIEC, et c’est sur ce dernier outil, ainsi que sur les ressources qui m’y ont conduites, que je souhaiterais maintenant revenir.
Utilisation de l’outil Climate Q&A qui décrypte les rapports du GIEC.

Exemple d’utilisation avec deux questions :
Quelles preuves avons-nous que le climat change ?
Nous disposons de plusieurs éléments de preuve indiquant que le climat est en train de changer de manière significative au cours du dernier siècle. Voici les principaux points à retenir :
Les études d’attribution montrent que les changements de température sont attribués à divers facteurs, tels que l’influence humaine totale, les gaz à effet de serre, les aérosols, l’ozone, les changements d’utilisation des terres, les éruptions volcaniques, et la variabilité climatique interne.
Les changements observés dans le climat sont associés à des activités humaines et sont catégorisés par différents niveaux de confiance scientifique, allant de moyen à virtuellement certain.
Des preuves issues de changements attribués dans les extrêmes climatiques et météorologiques soutiennent l’idée que même un réchauffement de 0,5°C supplémentaire par rapport à aujourd’hui entraînerait des changements détectables dans ces extrêmes.
Les rapports du GIEC soulignent que le système climatique change rapidement en raison de l’influence humaine, avec des changements documentés dans l’atmosphère, les terres, la cryosphère, la biosphère et les océans, ce qui représente un engagement à l’échelle millénaire pour les éléments du système climatique qui répondent lentement.
L’attribution des changements climatiques à l’influence humaine est devenue de plus en plus forte au fil des rapports du GIEC, avec des preuves solides montrant une influence humaine claire sur le système climatique.
Ces éléments de preuve combinés indiquent de manière indiscutable que l’influence humaine a contribué au réchauffement de l’atmosphère, des océans et des terres, confirmant ainsi le changement climatique en cours.
Quels sont les enjeux de l’utilisation de l’intelligence artificielle face aux changements climatiques ?
L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour aborder le changement climatique présente plusieurs défis, comme indiqué dans les documents fournis :
Les technologies numériques, y compris l’IA, peuvent contribuer à atténuer le changement climatique et à atteindre plusieurs objectifs de développement durable. Cependant, certains gains en matière de lutte contre le changement climatique peuvent être réduits par une augmentation de la demande de biens et services due à l’utilisation d’appareils numériques.
L’application de l’IA dans le domaine de la modélisation et de la prévision climatique est encore relativement nouvelle, avec des avancées principalement dans les domaines de la prévision météorologique, des rendements agricoles, des systèmes d’alerte précoce et de la gestion de l’eau.
Les défis liés à l’utilisation de l’IA pour lutter contre le changement climatique comprennent des coûts de formation et de logiciels, la demande des clients et du marché, ainsi que des problèmes juridiques et de gouvernance.
Les modèles d’analyse intégrée et leurs résultats pour fournir des stratégies de réponse au changement climatique ont été critiqués pour leur manque de crédibilité dans certaines hypothèses cruciales, notamment en ce qui concerne la disponibilité des technologies de capture du dioxyde de carbone.
En résumé, les principaux défis de l’utilisation de l’IA pour aborder le changement climatique incluent les coûts, la demande du marché, les problèmes juridiques, la crédibilité des modèles et la disponibilité des technologies nécessaires. Ces défis nécessitent une approche soigneusement planifiée et une gouvernance appropriée pour maximiser les avantages de l’IA dans la lutte contre le changement climatique.
Concernant la question posée sur l’intelligence artificielle, j’ajoute ici différentes captures d’écran qui donnent un aperçu du fonctionnement de l’outil, ce dernier mettant à chaque fois en relation ses réponses avec les rapports du GIEC, et proposant des illustrations :
Pour compléter cet outil voici une sélection d’articles qui en faisaient la présentation :
- « IA : le français Ekimetrics lance un « chatGPT » dédié au climat ». Les Echos, 7 avril 2023, https://www.lesechos.fr/tech-medias/intelligence-artificielle/ia-le-francais-ekimetrics-lance-un-chatgpt-dedie-au-climat-1933399.
- Monod, Olivier. « Qu’est-ce que Climate Q & A, la nouvelle IA pour lire les rapports du Giec ? » Libération, https://www.liberation.fr/environnement/climat/quest-ce-que-climate-q-a-la-nouvelle-ia-pour-lire-les-rapports-du-giec-20230411_OKLEL753XBHAVK6GPNK3XV72FU/. Consulté le 30 mars 2024.
- Morestin, Florine. « Climate Q&A : une IA pour décrypter les rapports du GIEC ». Novethic, 18 avril 2023, https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/climate-q-a-une-ia-pour-decrypter-les-rapports-du-giec-151460.html.