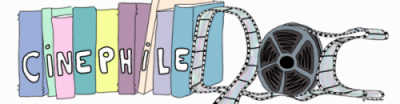J’avais l’habitude depuis quelques années, pour cet article cinéphile du mois de mars, d’essayer le plus possible de mettre à l’honneur les femmes, qu’elles soient actrices, réalisatrices, scénaristes ou youtubeuses.
J’ai donc regardé vers début janvier et jusqu’à la mi février ce qui était en tête de gondole dans les ouvrages sur le cinéma… cependant, rien parmi les biographies et les autres documentaires n’a pu retenir mon attention. Rien non plus du côté des romans ou des bandes-dessinées, qui aurait pu convenir.
Comme cette idée me tenait tout de même à coeur, je me suis retrouvée bien embarrassée, et début mars approchant, je n’avais toujours pas commencé ni à lire ce qui pouvait rentrer dans ce cadre, et encore moins à l’écrire.

Au moment où j’écris ces premières lignes, nous sommes le 3 mars, et j’ai décidé de consacrer cet article à une petite promenade parmi plusieurs thématiques et ouvrages, pour en venir à un sujet qui m’accapare ces derniers temps sur le plan professionnel mais aussi personnel.
Si l’article déroge à son intention annuelle, je me raccroche au fait que je lui cède mes préoccupations et envies du moment, et c’est déjà suffisant…
Cinéma : Vers des mondes imaginaires
Le point de départ de mes déambulations reste tout de même un ouvrage : une publication relativement récente de Christophe Lemaire, que j’ai trouvé par hasard en librairie.

Il s’agit d’un petit ouvrage qui a été édité en exclusivité par la FNAC, et qui était offert en fin d’année dernière lorsque l’on allait en magasin.
Ce n’est pas la première fois que la FNAC prend ce type d’initiative, puisqu’elle est également à l’origine de guides avec des incontournables en bandes-dessinées par exemple.
Ce guide « Cinéma : Vers des mondes imaginaires » est donc un petit condensé très bien pensé, et avec une écriture complice, voire parfois impertinente. L’auteur s’amuse avec son lecteur, à coups d’aparté, de traits d’humour, d’autres références et de parenthèses.

Trois formes d’itinéraires sont proposées, déclinées à leur tour en trois suggestions de voyages :
- du réel à l’imaginaire ;
- visions du futur ;
- mondes imaginaires
Pour le lecteur qui ne s’est jamais risqué dans ce type d’aventures, ce petit ouvrage sympathique fait office de mise en bouche (ou de pied à l’étrier), avec une perspective historique du genre ou des genres explorés, et des pistes d’exploration.
Ainsi la partie « Du réel à l’imaginaire », et son chapitre « Voyages dans le temps » évoquent tout autant les incontournables La Planète des singes, Retour vers le futur, Un jour sans fin, Edge of tomorrow et Interstellar.
Dans la partie « Mondes imaginaire », l’auteur accorde une brève sous-partie aux « Jeux vidéos et internet en folie ».
Évidemment, on retrouve dans cet ouvrage l’évocation en pointillés de l’intelligence artificielle, que ce soit avec des créatures et des ordinateurs (de Metropolis à Terminator en passant par HAL dans 2001 : l’odyssée de l’espace) ou avec l’évocation d’uchronies et de dystopies comme 1984 ou Matrix.
Le jeu vidéo est mentionné notamment avec le film Ready player one de Spielberg, même si ce dernier ne vaut pas le roman dont il est adapté (même pour une fan de Spielberg comme moi).
Bref, vous me voyez venir, cet ouvrage m’a donné envie de relier intelligence artificielle et cinéma, et pour cela, mes déambulations m’ont conduites vers différents ouvrages, films, séries télévisées et recherches sur Internet.
Intelligence artificielle au cinéma
Après cette évocation en pointillés dans le guide de Christophe Lemaire, je me suis demandé si cette question brûlante de l’intelligence artificielle avait suscité quelques publications récentes, non pas comme d’habitude dans le rayon 000 si l’on reprend notre classification décimale de Dewey (et plus précisément le rayon dédié à tout ce qui concerne l’algorithmie et la programmation), mais si par hasard un cinéphile avait décidé de consacrer un ouvrage entier à cette question.

Le seul ouvrage relativement récent, et sur lequel je n’ai pour l’instant pas pu mettre la main (ce qui m’attriste parce qu’il correspondait exactement à ce que je recherche) est : Génération I.A. :
Du coup, j’en ai été réduite à reprendre des ouvrages bien plus anciens et qui figuraient déjà dans ma bibliothèque (et qui restent des références, bien que certainement indisponibles désormais).
Parmi eux : Science et science-fiction, publié en 2010 (il s’agissait du catalogue d’une exposition proposée par la Cité des sciences), évidemment le pavé 100 de cinéma fantastique et de science-fiction de Jean-Pierre Andrevon, ou encore Rêves et séries américaines de Sarah Hatchuel.
J’ai également repris mes lectures sur l’intelligence artificielle et me suis replongée dans cette chronologie de la revue Le 1 :

Et je me suis aussi souvenue de la façon dont Laurence Devillers dressait le panorama des origines littéraires et cinématographiques de la robotique dans son ouvrage passionnant Des robots et des hommes : Mythes, fantasmes et réalités, publié en 2017.

Évidemment, j’ai aussi repris quelques-uns des ouvrages de SNT (Sciences numériques et technologie) en format papier et numérique, que j’avais déjà consultés pour préparer mes séances sur l’intelligence artificielle avec mes classes.
Et puis j’ai eu l’idée de consulter quatre outils sur la question, et je reproduis donc ci-dessous mes quatre itinéraires de recherche.
Intelligence artificielle et cinéma : 4 itinéraires de recherche
Itinéraire 1 : demander à une i.A.
J’ai tourné et retourné la question dans ma tête, et c’est (je le montrerai plus loin) l’humain qui m’a indiqué qu’une formulation trop large pouvait permettre évidemment d’aborder la question sous deux aspects, surtout si l’on s’intéresse aux applications les plus actuels de la question.
Mais j’ai aussi voulu comparer deux outils différents, et j’ai donc utilisé dans un premier temps le plus connu, à savoir Chat GPT.
Voici la réponse qu’il m’a apportée :

Je donne ci-dessous le lien de la réponse complète :
https://chat.openai.com/share/c36a3c3f-7824-4848-a3a5-a072bca699e8
itinéraire 2 : demander à une i.A. qui cite ses sources
En parallèle de Chat GPT, j’ai voulu tester l’outil Perplexity en lui posant rigoureusement la même question. La réponse apportée était plus concise mais me renvoyait vers cinq sources à consulter :
Par ailleurs, l’outil me renvoyait vers d’autres questions précédemment posées et pouvant compléter la question telle que je l’avais formulée :

Les questions connexes proposées (et indiquées ci-dessous en capture d’écran) ont fait le lien avec les deux autres outils de recherche que j’ai utilisés.

itinéraire 3 : se promener dans wikipédia
Ayant utilisé ces deux outils, je me suis dit que la question avait certainement été abordée dans un article de Wikipédia. J’ai cherché du coup un article dédié aux représentation de l’intelligence artificielle au cinéma, et je suis directement tombée sur le film de Spielberg : A.I. Intelligence artificielle.
Cela ne me convenait pas, je suis donc allée directement sur l’article consacré à l’intelligence artificielle, en utilisant l’outil Wikiwand (extension installée sur mon ordinateur) :

Cela m’a amenée à la catégorie connexe « Intelligence artificielle dans l’art et la culture », puis aux sous-catégories « Intelligence artificielle dans la fiction » et « Film sur l’intelligence artificielle ».
Je me suis souvenue que Wikiwand propose des outils d’intelligence artificielle justement pour résumer les articles de Wikipédia, et je suis donc retournée à mon point de départ :

Mais l’outil ne m’a pas proposé de me résumer la partie sur l’intelligence artificielle dans la science fiction, j’en donne donc directement le lien direct, cette partie étant finalement relativement synthétique…
itinéraire 4 : et si j’allais plutôt embêter un humain ?
Récemment dans le cadre de ma veille et de la préparation de mes formations, j’ai remis le nez dans un outil que j’avais utilisé de temps en temps, et je me suis souvenue de sa richesse et de son efficacité.
Le parallèle avec Chat GPT m’a d’ailleurs amusée, puisqu’il s’agit cette fois de poser une ou des questions à un humain. Certes, la réponse n’est pas automatique, mais elle reste rapide, et elle nous est donnée par un expert de la question.

Il s’agit du service Eurêkoi proposé par la BPI, et à qui j’ai posé la question : « Je cherche des informations sur l’intelligence artificielle au cinéma »
Moins de 24h après, j’ai reçu une réponse, dont je donne ici les premiers éléments, puisque cette réponse était assez détaillée et approfondie :
Bonsoir,
Vous avez fait au service de questions/réponses Eurêkoi la demande suivante : » Je cherche des informations sur l’intelligence artificielle au cinéma », sans plus de précision, c’est-à-dire sans que l’on sache si vous voulez des informations sur l’exploitation de l’IA par l’industrie cinématographique, ou si vous souhaitez des informations sur la manière dont l’IA apparaît, est présentée au cinéma, différents films (c’est un thème de science-fiction assez récurrent).=> Vu le contexte actuel, je vais supposer que c’est la première interprétation qui est la bonne, à savoir que vous voulez des informations sur l’exploitation de l’IA par l’industrie cinématographique.C’est visiblement tout le secteur qui se sent menacé, en tout cas remis en question, par l’explosion de l’IA, et notamment de l’IA générative dans la production de contenus. Les impacts de l’IA apparaissent sur différents secteurs : l’écriture du scénario, les effets spéciaux, la création d’image de synthèse d’acteurs ..Sur l’exploitation de l’IA au service des effets spéciaux, vous pouvez consulter le dossier en plusieurs articles de Futura sciences, intitulé Effets spéciaux et intelligence artificielle, par Floriane Boyer (date ?).Extrait : « Comme on vient de le voir, l’IA pourrait remplacer la technique de motion-capture pour créer des personnages virtuels. […] es progrès exponentiels des ordinateurs remettent-ils donc en question le rôle futur des acteurs au cinéma et celui des animateurs humains qui conçoivent les films d’animation ? L’IA saura-t-elle un jour fabriquer toute seule des images de synthèse ? Ou créer un être humain virtuel de toutes pièces pour en faire l’acteur principal de son film ? Depuis peu, elle s’essaie même à la rédaction. Peut-être pourra-t-elle un jour réaliser un film en entier, scénario compris, sans assistance humaine ? «Ou encore, sur le même site, cet article : Cette IA qui va révolutionner les effets spéciaux dans les vidéos, par Edward Back, 10/02/2023.Extrait : » Runway est connu pour son IA Stable Diffusion capable de générer des images à partir d’une phrase, à l’instar de Dall-E ou Midjourney. Gen-1 fonctionne un peu comme un filtre Snapchat, mais d’une manière beaucoup plus évoluée. Il faut partir d’une vidéo de base qui servira à fournir à l’IA les éléments de la scène, et les mouvements à reproduire. Indiquez-lui alors le style à utiliser, ou fournissez une image d’exemple, et elle va l’appliquer sur toute la vidéo.
Je pourrais reproduire le reste de la réponse qui est tout aussi pertinent et intéressant.
Ce qui m’a amusée en premier lieu, c’est que la bibliothécaire qui m’a fourni la réponse a directement pointé ce que l’on peut désigner comme la « faiblesse de mon prompt ».
Et cela m’a ramenée à la réalité que l’on constate, quel que soit l’outil ou la personne que l’on interroge : une question, lorsqu’elle n’est pas correctement formulée, ne nous apporte pas (toujours) la réponse pertinente, c’est-à-dire celle qui répond à notre besoin d’information.
En l’occurrence, concernant les liens entre intelligence artificielle et cinéma, les deux aspects de la question m’intéressent tout autant… et d’ailleurs, alors que j’indique le service Eurêkoi comme mon quatrième itinéraire, c’est celui que j’ai utilisé en premier.
Mais il me révèle bien, à moi aussi, en tant qu’usager peut-être un peu paresseux des outils de recherche d’information, à quel point même en essayant de tourner et de retourner dans ma tête la formulation de ma question (ce que j’avais fait trois fois avant de l’envoyer), elle persistait à manquer de précision pour le service humain que j’interrogeais.
Je suis donc retourné vers le service et j’ai demandé quelques approfondissements sur le sujet, en complément de ceux que j’avais déjà pu trouver par moi-même :
- d’autres éléments sur la façon dont on représente l’intelligence artificielle au cinéma ou dans les séries télévisées (et ce avec des exemples récents autres que peut-être les traditionnels HAL de 2001 l’odyssée de l’espace ou Terminator ou encore Her)
- des titres d’ouvrages sur le cinéma et les séries télévisées où la question est abordée (je n’en ai trouvé qu’un : Génération IA, publié en 2020, et qui ne semble plus édité).
Le service permettant (comme Perplexity mentionné plus haut) de retrouver les autres questions posées par les usagers, j’ai pu consulter également une question qui traitait de la façon dont l’intelligence artificielle apparaît dans les films et séries télévisées.

Cependant, la question posée par l’usager remontant à 2018, j’espère avoir prochainement des éléments de réponses actualisées fournies par Eurêkoi, et je les ajouterai éventuellement à la fin de cet article.

D’ici là, je vous donne rendez-vous prochainement pour l’article #profdoc du mois de mars ou un autre article sur l’intelligence artificielle, et vous dis à très bientôt sur Cinéphiledoc.