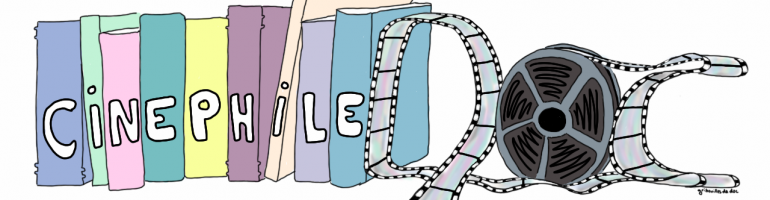L’entretien est l’une des formes privilégiées qu’adoptent les revues spécialisées et les ouvrages sur le cinéma. Rendus célèbres notamment par les Cahiers du cinéma, dont les critiques – futurs cinéastes – sont allés régulièrement interroger leurs pères spirituels (André Bazin, Hitchcock…), puis leurs pairs, ils sont devenus l’une des références en matière de cinéma sous la forme du Hitchbook.
La bible du cinéphile
Qu’est-ce que le Hitchbook ? J’ai déjà eu l’occasion d’en parler. Le Hitchbook, ce sont les entretiens menés par François Truffaut avec Alfred Hitchcock, et publiés pour la première fois en 1966. En 1983, l’ouvrage a fait l’objet d’une réédition qui ajoute au texte une préface et un dernier chapitre consacré aux derniers films d’Hitchcock.
Durant ces entretiens, les deux cinéastes vont aborder tous les aspects de la vie et de l’oeuvre d’Hitchcock – enfance, genèse de chaque projet, secrets de fabrication des scènes majeures de la mythologie hitchcockienne (la scène de la douche de Psychose, différentes scènes de la Mort aux trousses, etc.) – mais surtout, ils vont donner au lecteur une « leçon de cinéma ». Le Hitchbook est la bible du cinéphile, une référence, l’un des seuls, voire le seul, textes à garder, à lire et à relire sur le cinéma.
Pour une présentation de cet ouvrage par celui qui en est à l’origine, voir cette vidéo de l’INA, vidéo que je n’ai malheureusement pas réussi à intégrer dans le corps de l’article.
Les entretiens Hitchcock / Truffaut sont un modèle souvent copié, rarement égalé pour donner la vision d’une oeuvre de cinéaste, le panorama d’une époque ou d’un univers (pays, continent) cinématographique, ou du cinéma en général. Depuis 1966, les entretiens ont été menés par des cinéastes, critiques, ou cinéphiles auprès des cinéastes les plus célèbres.
Quelques exemples :
- Truffaut s’est lui-même livré à l’exercice des entretiens entre 1959 et 1984, rassemblés dans Le Cinéma selon François Truffaut, par Anne Gillain, publiés en 1988 aux éditions Flammarion.
- Egalement avec Truffaut, les entretiens radiophoniques menés par Claude-Jean Philippe sous le titre Mémoires d’un cinéaste, et que la boutique de l’INA propose sous forme de deux CD.
- Les entretiens d’Orson Welles avec Peter Bogdanovich publiés en 1997 aux éditions du Seuil (collection Points virgule) sous le titre Moi, Orson Welles.
- Les Entretiens avec Woody Allen, d’Eric Lax, publiés en 2008 aux éditions Plon, qui rassemblent les interviews menées par l’auteur avec Woody Allen entre 1971 et 2008.
- Tim Burton : entretiens avec Mark Salisbury, publié en 2009 aux éditions Sonatine. Pénétrez dans l’univers du maître du fantastique.
- Conversations avec Claude Sautet, de Michel Boujut, parues en 2001 aux éditions Actes Sud, et malheureusement épuisées.
La liste pourrait être encore longue…
Généralement, ce type d’entretiens, qu’il s’agisse d’une longue et unique rencontre leur donnant naissance ou que les deux protagonistes se retrouvent à intervalles réguliers, fait la rétrospective d’une oeuvre, d’un parcours cinématographique.
Cependant, l’ouvrage qui m’intéresse aujourd’hui choisit un autre angle d’attaque.
Un instant T du cinéma
Par manque de temps, je n’ai pas pu lire et publier avant cet article. Le livre que j’ai retenu pour ce mois-ci est donc paru en avril 2014 – mais il est également vrai que, comme je l’ai déjà signalé, il y a en ce moment relativement peu de publications sur le cinéma, même dans le rayon fictions, si l’on exclut tout ce qui paraît actuellement sur Grace Kelly.
D’ailleurs, si j’ai choisi de n’aborder aucune de ces biographies, ce n’est pas parce que j’ai arbitrairement décidé de « black-lister » Grace Kelly de ce blog – j’ai déjà eu l’occasion de lui consacrer un article – mais parce que je ne voulais pas choisir entre toutes ces publications qui me semblaient surfer sur la vague du glamour / people / sensation / mélo.
Bref, ayant, comme à mon habitude, digressé d’un sujet à l’autre, je présente enfin le livre retenu. Une renaissance américaine : entretiens avec 30 cinéastes, de Michel Ciment, est paru aux éditions Nouveau monde, dans la collection Cinéma.
Comme l’indique son sous-titre, il rassemble des entretiens réalisés avec 30 cinéastes américains, ayant commencé leur carrière de réalisateurs entre les années 1970 et 1980, après l’âge du muet et l’âge d’or d’Hollywood. Leur cinéma est le témoignage d’un changement radical dans la société américaine.
Réalisés en une fois pour chaque réalisateur, lors de la sortie d’un de ses films (petit budget ou grosse production), ces entretiens sont à la fois le témoignage d’un instant pris sur le vif (à un certain moment d’une oeuvre) et l’occasion, finalement, d’une rétrospective du cinéma américain .
Les réalisateurs interrogés sont alors souvent en début de carrière, ou n’ont pas encore réalisé les œuvres pour lesquelles le grand public les connaît le mieux, et ces entretiens témoignent donc de tout ce qu’il y a d’embryonnaire dans une oeuvre.
30 instants du cinéma américain
Dans ce recueil de Michel Ciment, on retrouve donc, par ordre alphabétique, 30 cinéastes américains : entre autres, Woody Allen (1994 : Coups de feu sur Broadway), Tim Burton (1991 : Edward aux mains d’argent), Coppola, Clint Eastwood, Stanley Kubrick (1987 : Full metal jacket), George Lucas avant le triomphe de Star Wars (1977 : American Graffiti), Sydney Pollack, Martin Scorsese, Quentin Tarantino avant Pulp fiction (1992 : Reservoirs dogs) ou encore Robert Zemeckis.
Chaque entretien est précédé d’une photo en noir et blanc du réalisateur et d’un court texte d’introduction, retraçant sa carrière et le contexte dans lequel cet entretien a été réalisé.
Les entretiens sont livrés dans une forme un peu brute, les portraits en noir et blanc étant les seuls illustrations de l’ouvrage. Cette forme aride peut décourager le lecteur, c’est l’inconvénient majeur de cet ouvrage.
Son avantage en revanche, c’est la forme même des entretiens multiples, des textes que l’on peut lire dans le désordre et en ouvrant le livre au hasard, qu’on ait envie de « lire la voix » de Tim Burton, de George Lucas ou de Tarantino – curieusement, le grand absent restant Spielberg…
Un autre de ses avantages, c’est la découverte à chaque fois d’un regard singulier sur le cinéma. Chacun offre au lecteur cet amour pour son art dans tout ce qu’il a d’unique pour lui : Woody Allen et sa passion des ambiances de jazz, George Lucas et ses références de science-fiction, Tim Burton, ses souvenirs du cinéma d’horreur et sa manière si singulière de peindre des petites villes américaines proches de celle de son enfance.
Le tout est riche, dense, foisonnant, et donne envie de se replonger dans l’univers de chacun d’eux, pour en retrouver les images, les décors, les créatures et les sons.
A compléter avec :
- Amis américains. Entretiens avec les grands auteurs d’Hollywood, de Bertrand Tavernier, paru en 2008 aux éditions Actes sud ;
- Mythes et idéologie du cinéma américain, ouvrage consacrés principalement aux films de science-fiction et catastrophes, que j’ai eu l’occasion d’évoquer dans un article – article ayant fait polémique :
- L’Amérique évanouie, circuit dans les décors naturels américains des films d’horreur et de suspense, entre autres. Article à retrouver ici.