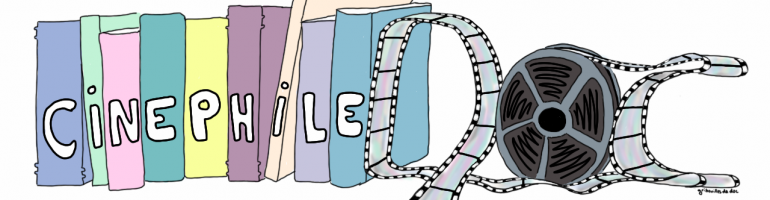Vous l’avez peut-être deviné, voici un nouveau petit voyage en deux parties, après les deux articles consacrés à Hitchcock au début de l’année. Grâce à mes deux lectures du moment, je vous invite à plonger dans l’intimité tantôt scabreuse, tantôt miteuse de la Mecque du cinéma.
Spectateurs et voyeurisme
Qu’il affiche un goût prononcé pour le cinéma d’auteur ou pour les films catastrophes, qu’il collectionne les affiches ou les autographes, qu’il vénère SA star avec un fanatisme pas trop envahissant ou qu’il soit complètement dérangé, le cinéphile est d’abord et avant tout un voyeur, qui observe d’autres voyeurs – réalisateurs, scénaristes, producteurs – eux-mêmes mettant en scène et se rinçant l’œil devant les névroses et les angoisses des comédiens et de leurs personnages.
De Fenêtre sur cour (1954) à Dans la maison (2012), il s’agit simplement d’imaginer, ou d’exagérer la vie d’un être qui n’est pas tout à fait ce qu’il laissait supposer. Représentant de commerce à l’épouse absente ou assassin méticuleux ? Famille de « la classe moyenne » ou créature aux multiples fins et aux multiples possibilités d’interprétation pour l’écrivain en herbe qui les observe ?
Les réalisateurs filment des voyeurs, pour notre plus grand bonheur à nous, qui ne pouvons pas nous empêcher de regarder ce qui se passe à une fenêtre éclairée ou derrière une porte laissée ouverte, comme l’explique parfaitement Hitchcock :
Je vous parie que neuf personnes sur dix, si elles voient de l’autre côté de la cour une femme qui se déshabille avant d’aller se coucher, ou simplement un homme qui fait du rangement dans sa chambre, ne pourront s’empêcher de regarder. Elles pourraient détourner le regard en disant « Cela ne me concerne pas », elles pourraient fermer leurs volets, eh bien ! elles ne le feront pas, elles s’attarderont pour regarder. (p.179, Hitchbook)
Les voyeurs et la machine à scandale
C’est donc tout naturellement qu’on lit, qu’on regarde, qu’on scrute, qu’on écoute. Les ragots, la rumeur, les potins, tout ce qui va du murmure jusqu’au vacarme du scandale enfin révélé nous comble généralement de joie, en tout cas nous permet de passer un agréable moment.
C’est la fameuse littérature de salon de coiffure : on pioche un magazine au hasard, vieux de six mois minimum, et on tombe sur une « affaire », ou sur un « drame », qui a bien dû être passionnant pour susciter tant d’intérêt à sa publication, mais qui n’est plus guère désormais que le moyen de calmer son angoisse pendant que le coiffeur nous massacre ou en attendant un détartrage…
Mais parfois cette presse de caniveau peut connaître une nouvelle heure de gloire, et peut susciter chez certains, une vocation d’archéologue, entre les épluchures de légumes et les croûtes de pizzas. Elle peut même se faire une place dans la mémoire du cinéma, en ayant dévoilé la fin tragique, le passé tumultueux ou le squelette dans le placard (formules éculées au possible) de telle ou telle étoile.
Dans les rues de la ville fantôme.
Restituer cette mémoire et cette atmosphère moitié clinquante, moitié empoisonnée de l’âge d’or hollywoodien, voilà l’esprit du livre de Kenneth Anger, Hollywood Babylone, publié en 1975, et pour la première fois en français aux éditions Tristam, en mars 2013.
C’est un livre de format souple, assez court – 300 pages, mais généreusement illustré – à la quatrième de couverture rose fluo, et à la première de couverture tape-à-l’œil, puisque dans toute sa longueur s’y étale Jayne Mansfield, sa plantureuse poitrine et sa blondeur.
Jamais un livre n’a autant proclamé et dénoncé, avec humour et parfois mélancolie, ce qu’il va mettre en scène : les flash des photographes, les scandales des people, le règne du faste et du faux.
L’ouvrage s’ouvre sur le poème d’un certain Don Blanding, poète américain de la première moitié du vingtième siècle :
Hollywood, Hollywood… / Fabuleuse Hollywood… / Babylone de Celluloïd, / Glorieuse, splendide… / Cité fiévreuse, / Frivole et consciencieuse…
Poétiquement, on a fait mieux. Voici un poème avec trop de –euse, et que l’on quitte volontiers pour retrouver l’évocation, bien meilleure, du Hollywood et de son âge d’or, sous le regard de Griffith et de son film Intolérance, réalisé avec faste en 1915 :
Une montagne d’échafaudages enchevêtrés, des jardins suspendus, des remparts pour courses de chars et de gigantesques éléphants, un mirage artificiel de la Mésopotamie, déposé sur les tranquilles maisons de style mission espagnole massées au milieu des orangeraies, qui composaient le Hollywood de 1915, en prélude aux temps à venir.
Les temps à venir, ce sont ceux des scandales du muet. J’ai déjà eu l’occasion de mentionner celui de Roscoe « Fatty » Arbuckle, arrêté pour le viol et le meurtre d’une jeune femme à peine actrice, puis acquitté, mais dont la carrière avait été brisée (la voilà, la fin).
On y retrouve les stars sombrant dans l’alcoolisme ou shootées à la cocaïne et à l’héroïne, les affaires sexuelles de Chaplin, de Errol Flynn, accusé de pédophilie, les stars adeptes du sadomasochisme, les bisexuelles, la prostitution, la folie, les meurtres et les procès, le tout accompagné de doutes, de rumeurs et de suicides. On effleure le maccarthysme et on aperçoit de loin les Dix d’Hollywood.
On y entrevoit le fonctionnement de la « presse de caniveau » et de ses principales hyènes : le magnat William Randolph Hearst, les sorcières des potins Louella Parsons et Hedda Hopper.
L’ouvrage se referme sur une séquence coupée de la comédie musicale Moulin rouge (version de 1934), sur une chanson dont les premiers mots sont :
J’erre le long de l’allée du chagrin / Le Boulevard des Rêves Brisés
Errances et décadences…
Lorsqu’on lit ce livre, qui alterne avec virtuosité ce ton léger, plaisant et plein d’humour propres aux anecdotes croustillantes, et le ton désabusé du regard jeté sur une époque révolue, on pense à des films comme Citizen Kane ou Sunset Boulevard, qui ne sont que démesure et décadence. Ce n’est pas pour rien que l’on a surnommé les années 20, âge glorieux d’Hollywood et de ses scandales, les « roaring twenties » (les années 20 rugissantes) et « the lost génération » (la génération perdue, nom donné à la littérature américaine de cette période, incarnée magnifiquement par Francis Scott Fitzgerald et son fabuleux Gatsby).
Derrière les fastes des décors et des maquillages, derrière les sourires et le jeu des comédiens, c’était l’illusion d’une vie privée qui ne l’était pas, et fatalement, qui était condamnée à être révélée au grand jour, à briser les carrières et les vies.
Voilà le Hollywood côté stars… à très vite pour le Hollywood des anonymes, ou presque !