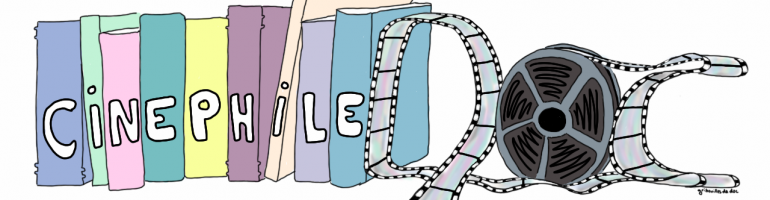Chercher le geek
Avec un peu d’avance, voici l’article de la rentrée. Je n’aurais pas pu faire, je n’aurais pas pu souhaiter un article plus fédérateur que celui-ci, et qui peut s’adresser aussi bien aux cinéphiles qu’aux profs-docs, et aux littéraires qu’aux scientifiques.
Au cours de mes déambulations en librairie et de mes vagabondages sur Internet, je cherchais quelque chose d’alléchant dans les nouveautés cinéma. Pendant un certain temps, échec. Quand, par hasard, je suis tombée sur le genre de livre dont on se dit : « Il me le faut, celui-là, il me le faut. » (réaction comparable à celle que l’on a face au dernier vêtement à sa taille un jour de soldes… quoique je ne sois pas sûre que ce soit la comparaison la plus appropriée !)
Culture geek est un ouvrage de David Peyron, docteur en sciences de l’information et de la communication, paru en août 2013 aux éditions Fyp. Culture geek, pourquoi ? Parce que l’auteur tente en quelques chapitres, de cerner ce que recouvre l’identité auto-revendiquée du geek, de nous la faire comprendre et reconnaître.
Qui est le geek ?
Le livre de David Peyron n’est pas un catalogue de tout ce qu’est le geek et de tout ce qu’il aime – littérature, informatique, cinéma, comics, jeux de rôle, séries télévisées. Cependant, il nous entraîne dans l’histoire fascinante de l’émergence du terme « geek ». Brièvement, il nous semble retrouver dans ce portrait quelques éléments de l’Histoire de la folie à l’âge classique, de Foucault. À l’origine, en effet, au Moyen-âge, le « geek » (orthographié geck puis gecken) désigne soit l’idiot du village, soit un monstre de foire :
Il était généralement présenté comme un enfant sauvage (…). En réalité il s’agissait généralement d’un vagabond que les organisateurs payaient pour assurer le spectacle, d’un handicapé mental ou d’un membre de la troupe n’ayant plus les capacités physiques d’assurer ses prestations habituelles (…). Le spectacle du geek consistait à avaler tout ce qui se présentait à lui : bris de verre, pierres, objets divers. (…)
Le geek est ainsi un « idiot social » qui a du mal à communiquer. Avec l’autre acception qui garde les traces d’une forme de marginalité, arrive l’idée d’une capacité surhumaine (qui peut être feinte) à avaler tout et n’importe quoi avec avidité, et ce de manière pantagruélique et indistincte.
Au fil des pages, et au hasard des exemples que donne David Peyron, on retrouve les traces de cet appétit insatiable : de Tolkien à Terry Pratchett (en passant par Douglas Adams, Asimov, Frank Herbert, Max Brooks, George Martin) pour la littérature, de Star Trek à Fringe (en passant par X-Files, Doctor Who ou encore The Big bang theory) pour les séries télévisées, et de Star Wars au Seigneur des anneaux (en passant par Retour vers le futur, Matrix et les adaptations des studios Marvel) pour les films.
Quoiqu’il en soit, pour l’auteur, le geek est un curieux, un passionné, dont l’intérêt pour un univers le pousse sans cesse à approfondir, à éprouver la cohérence de cet univers, et à le faire déborder de son support originel :
Ce peut être le style, ou encore les personnages qui font que des geeks aiment telle ou telle oeuvre, mais le plus important est l’univers, l’arpenter, se l’approprier de manière toute personnelle et en faire un terrain connu. Ce qui prend du temps. Que ce soit par la relecture, le revisionnage, ou le rétrogaming, le temps long (de la fiction et de la réception), la fidélité à l’objet et le retour vers lui permettent de décrire ce qui fait le sel de la passion. Cela renvoie à un rapport spécifique, expert, poussant chaque univers à ses limites, chacun à sa manière. Dans cette perspective, chaque support ajoute sa pierre à l’édifice de la pratique de ces mondes comme sorte de bacs à sable, d’objets ludiques et emplis de potentiels. Le jeu est une fiction, la fiction est un jeu et le monde est un terrain ludique, d’engagement et d’appropriations multiples.
Pour mieux cerner une identité si foisonnante et si dispersée, David Peyron dégage trois aspects majeurs de la culture geek, et ce au-delà des conditions scolaires et sociales originelles du geek, même si ces dernières sont également abordées. Il s’agit de la convergence culturelle, du rapport transmédiatique aux oeuvres et de l’érudition par le détail.
Culture transmédiatique, convergence et érudition
L’exemple le plus parlant pour évoquer l’aspect transmédiatique de la culture geek est Star Wars. C’est en tout cas l’exemple, parmi tant d’autres, que choisit d’exploiter l’auteur. Il s’agit de la propension d’un univers geek à s’étendre, c’est-à-dire aussi bien à s’approfondir sur le plan géographique, sociologique, historique, qu’à s’exporter vers d’autres formats.
Star Wars, ce n’est pas seulement un film, c’est une série de romans qui explorent les confins de la galaxie, exploitent les personnages secondaires, étudient les langues et la culture des différentes civilisations. Ce sont aussi des comics, des produits dérivés, des jeux, des séries télévisées. Tout pour répondre à l’appétit des geeks, à leur besoin d’appropriation, de collection et d’extension de leurs univers favoris.
La convergence découle de cette culture transmédiatique : il s’agit de la propension des différents médias à être des références les uns pour les autres (livres pour films, films pour livres, films pour jeux vidéos…) et des geeks à passer allègrement de l’un à l’autre. Les oeuvres ne sont plus des entités fermées : elles deviennent, à l’instar de Star Wars, des univers hyper-approfondis, hyper-référencés, que vont à leur tour étendre les geeks, puisqu’ils vont eux-mêmes produire des « hommages », des citations, et des extensions référencées de ces univers (vidéos, fanfictions, mèmes, etc.).
Enfin, l’érudition est ce qui permet au geek de se construire en tant que tel, de s’affirmer par la connaissance la plus poussée possible qu’il ait de l’univers de prédilection. Saisir la petite phrase, l’élément de décor qui fait sens dans un film, ou l’incohérence, la faille qui émerge d’un autre, c’est pouvoir revendiquer un regard d’expert sur l’oeuvre, et la reconnaissance de ses pairs.
Trouver le geek
À tous ceux qui veulent comprendre et apprivoiser cet étrange animal qu’est le geek, à tous ceux qui se demandent si un jour ou l’autre ils seront dignes de revendiquer cette identité, à ceux qui sont simplement intrigués ou fascinés par cette façon gloutonne de s’approprier l’information et de la partager, ce livre soulèvera peut-être un pan du mystère. On s’y plonge avec plaisir, un plaisir communicatif que l’auteur a bien su nous faire partager :
En 2007, lorsque je commençais à explorer ce que pouvait être le style geek et comment le caractériser, j’ai découvert un tee-shirt mis en vente sur internet. On pouvait y lire une phrase écrite en blanc sur fond noir : « I never got my acceptance letter from Hogwarts, so I left the Shire to become a Jedi. » (…) À lui seul, ce tee-shirt résume une grande partie du propos de ce livre, et la manière ludique et pulp dont les geeks s’emparent d’objets populaires pour en faire une identité affichée, revendiquée et transmédiatique.
Une chose cependant est sûre : personne n’a besoin d’un livre pour se prouver à lui-même qu’il est absolument ce qu’il croit être. Les geeks auront-ils besoin de ce livre ? Pas nécessairement. Si ce n’est pour une simple promenade de reconnaissance plutôt agréable, qui les fera sourire, et qui fourmillera, pour eux, de clins d’oeil.