Deuxième partie.
Voici comme promis la suite de l’un des hors-séries de l’été. J’avais évoqué en première partie aussi bien Sartre que Fitzgerald, Agatha Christie, Paul Auster, et quelques autres. Pour compléter en beauté ce palmarès déjà glorieux, je me suis plongée dans mes souvenirs de lectures et dans quelques nouveautés, du moins pour moi. J’évoquerai les souvenirs assez rapidement, puis je m’attarderai un peu plus sur quelques titres qui m’ont marquée cet été.
Dans cette sélection, on peut distinguer deux types de romans : ceux qui inventent un monde entièrement fruit de leur imagination, ou de leur vision du cinéma ; et ceux qui jouent avec leurs souvenirs, leurs expériences personnelles et qui impliquent dans leur récit des personnages dont on ne sait plus très bien s’ils sont réels ou fictifs. Sans doute cette distinction ne semble-t-elle pas très parlante d’emblée, mais attendez, et vous allez comprendre…
Le cinéma imaginé
Le Dernier Nabab
J’avais déjà évoqué dans la première partie un roman de Fitzgerald, Tendre est la nuit, où le cinéma intervient en « toile de fond » (sans mauvais jeu de mots), puisque l’un des personnages principaux est une jeune comédienne sous contrat avec Hollywood. Hormis une projection, quelques références et une visite dans un studio parisien, le lecteur n’est cependant pas confronté directement à l’univers hollywoodien.
En revanche, dans Le Dernier nabab, roman inachevé de Fitzgerald, l’image se fait plus précise. L’histoire se passe en 1935 et suit les traces d’un personnage énigmatique, producteur de cinéma virtuose, Monroe Stahr. Ce dernier s’inspire d’un célèbre producteur de l’âge d’or d’Hollywood, Irving Thalberg. Pour ma part, il me rappelle également des êtres réels ou fictifs tels que William Randolph Hearst, Charles Foster Kane (héros du film de Welles, Citizen Kane, lui-même inspiré de Hearst), ou encore Howard Hughes (incarné à l’écran par Leonardo di Caprio dans Aviator).
Monroe Stahr – et la narratrice qui l’observe par moment – nous conduit dans le Hollywood / Babylone des années 30, fastueux, artificiel, scandaleux, cynique et profondément désenchanté, même si cela a trait davantage à l’univers de Fitzgerald, à ses Gatsby et ses Dick Diver, qu’au cinéma. Notre producteur de cinéma est, comme les héros précédents de Fitzgerald, tourmenté par son amour pour une jeune femme qui s’avère être le quasi-sosie de son épouse disparue – un petit côté Vertigo avant la venue d’Hitchcock aux Etats-Unis.
Décors, rushes, grandeurs et décadences, réalisateurs et scénaristes, voilà la fresque que restitue Fitzgerald, et qu’il devait lui-même avoir sous les yeux durant les dernières années de sa vie, en tant que scénariste à Hollywood. Petit extrait :
À aucun moment de la journée, un studio n’est absolument silencieux. Il y a toujours une équipe de techniciens dans le laboratoire, les auditoriums de doublage, les gens du service de maintenance qui passent à la cantine. Mais les bruits sont tous différents : un chuintement de pneus, le moulin tranquille d’un moteur qui tourne à vide, le cri nu d’une soprano qui chante dans un micro cerné de nuit.
Un sang d’aquarelle
Parmi mes souvenirs de lecture, j’ai retrouvé un roman de Françoise Sagan, publié en 1987. Pour ceux qui considère Françoise Sagan exclusivement comme l’auteur de Bonjour Tristesse, amoureuse de personnages qui brûlent la chandelle par les deux bouts, je n’ai qu’un message : lisez d’autres romans. Lisez Aimez-vous Brahms ?, qui est superbe ; lisez Des Bleus à l’âme – mon préféré – une merveille ! Et lisez Un sang d’aquarelle.
Ce roman vous prouvera la virtuosité de Sagan quand il s’agit de reconstituer une époque et une atmosphère, avec beaucoup d’ironie, ce qui ne gâche rien, bien au contraire. L’atmosphère en question, c’est celle de l’occupation. L’histoire se déroule en 1942, à Paris. Le réalisateur allemand Constantin von Meck, ancienne étoile hollywoodienne revenue tourner un film pour les studios de l’UFA, est tiraillé entre la révolte que suscite en lui l’Allemagne nazie, et sa propre passivité politique, son « sang d’aquarelle ». Ce roman est l’histoire d’un homme qui se cherche, et qui après les compromis et les atermoiements, décide enfin de sa conscience.
Eléonore à Dresde
Autre souvenir de lecture, ce très court roman de Hubert Nyssen, fondateur des éditions Actes Sud. J’ai toujours beaucoup aimé ses textes, vertigineux et énigmatiques, amoureux fous de la littérature et du cinéma. De lui, je vous recommande également La Leçon d’apiculture et Quand tu seras à Proust, la guerre sera finie.
Eléonore à Dresde raconte la rencontre d’une femme étrange, ancienne vedette d’un unique film qui la poursuit comme une malédiction, et d’un ethnologue. Eléonore est prisonnière de ce personnage qu’elle a incarné adolescente, et qui ne l’a plus quitté depuis :
Oui, Eléonore Simon, celle qui, quinze ans plus tôt, avec son premier film – Dresde, un soir – d’un seul coup, avait atteint la perfection, imposant son nom (…). Mais en même temps elle avait, d’une certaine manière, achevé sa carrière car, dans les rôles qu’on lui avait offerts ensuite, jamais elle n’était parvenue à faire oublier l’inoubliable héroïne de Dresde.
Le cinéma réinventé
Les ouvrages que j’ai cités jusque-là sont des oeuvres entièrement d’imagination. Bien que Fitzgerald ait été scénariste, et bien que Sagan et Nyssen aient voulu rendre hommage au cinéma, bien que les personnages empruntent leurs traits à telle ou telle célébrité, l’auteur a bel et bien créé un monde à part entière. Pour les romans qui vont suivre, la frontière entre réel et fiction est moins nette, elle se perd dans le flou artistique construit par les différents auteurs que je vais maintenant évoquer.
Blonde
Une fille au corps luxuriant dans la plénitude de sa beauté physique. Dans une robe bain-de-soleil en crêpe georgette ivoire, les seins moulés dans les plis soyeux onduleux de l’étoffe. Elle est debout, jambes nues écartées sur une grille de ventilation du métro new-yorkais. Sa tête blonde est extatiquement rejetée en arrière tandis qu’un courant d’air soulève sa large jupe évasée, révélant une culotte de coton blanc. Du coton blanc ! La robe de crêpe ivoire flotte, magiquement aérienne. La robe est magique. Sans cette robe, la fille serait de la viande femelle, étalée crue aux regards.
Il suffit de quelques lignes de Blonde, le roman de Joyce Carol Oates publié en 2000, pour suggérer l’image parfaite de Marilyn Monroe. Ou plutôt, son portrait fantasmé, un peu à la manière de cet ouvrage sur Greta Garbo, dont j’avais parlé au mois d’avril. Blonde est particulier.
Bien que nous ayons la certitude qu’il s’agit d’une invention, d’une longue rêverie sur ce qu’était ou ce qu’aurait pu être Marilyn, parfois un doute nous effleure : n’est-ce vraiment qu’un rêve ? Dans Blonde, l’être (Norma Jeane), le comédien (Marilyn) et le personnage de Oates – ou le mythe qu’elle en fait, si vous préférez – toutes ces identités tantôt se dispersent, tantôt se mélangent.
Blonde, c’est l’histoire d’une femme à la recherche d’une identité toujours vacillante. Nous plongeons dans ce rêve vaporeux, dans cette illusion charnelle qui s’appelle Marilyn pour finalement comprendre que nous participons tous à la construction de ce mythe, alors que la vraie femme n’en finit pas de nous échapper (à ce titre je recommande également la lecture des écrits de Marilyn, publiés sous le titre Fragments).
Le roman Blonde est la restitution d’une vie dans l’illusion permanente du cinéma.
Le Théorème d’Almodovar
Le Théorème d’Almodovar, d’Antoni Casas Ros, publié en 2008, repose sur la même illusion, la même confusion entre réel et imaginaire. Il s’agit d’un récit à la première personne d’un homme seul, défiguré après un accident, passionnés des mathématiques, de Newton et des livres. Il se réfugie au cinéma pour échapper au regard des autres et évoque une rencontre avec Almodovar, qui lui permettrait, à lui, être déconstruit, difforme, d’acquérir une forme nouvelle, transfiguré par la création cinématographique.
C’est un roman curieux, où le texte réfléchit sur lui-même et se produit de lui-même, une invention à la limite de la science-fiction. Et c’est un bel hommage au cinéma et à l’univers d’Almodovar :
Tout grand film nous fait tituber, nous laisse un moment ou une éternité dans cette sensation planctonienne un peu molle, flottant entre deux eaux. Ce sentiment vague que nous pouvons enfin vivre comme un héros, que nous pouvons traverser la vie plutôt que la fuir. Dans ces moments de grâce, nous sentons notre fragilité, nous palpons notre chair indécise, nous permettons au rêve intense de la beauté de surgir et de nous emporter.
Jeune fille et Une année studieuse
Pour finir, j’évoquerai deux textes que j’ai lus cet été avec beaucoup de plaisir, deux romans de Anne Wiazemsky. Si l’auteur choisit la forme du roman, elle n’en évoque pas moins des souvenirs personnels dans ces deux textes, l’un, Jeune fille, consacré au tournage du film Au hasard Balthazar, de Robert Bresson, en 1965, l’autre, Une année studieuse, consacré à sa rencontre en 1966 avec Jean-Luc Godard.
Au-delà d’une déclaration d’amour sans équivoque au cinéma, ce que j’ai aimé dans ces deux romans, c’est le récit captivant de la vie politique, artistique et cinématographique d’avant Mai 68, tout un bouillonnement intellectuel, un frisson auquel nous convie Wiazemsky.
Dans Jeune fille, on découvre le processus de création, qui conduit une jeune fille, au fil des lectures, des essais, et du quotidien du tournage, à devenir le rôle principal d’un film :
Je me suis mise à aimer profondément, à aimer d’amour, le quotidien d’une vie de tournage, cet instant entre le « Moteur ! » et le « Coupez ! » quand toutes les respirations sont suspendues et que seuls comptent des gestes à faire, des mots à dire. J’aimais cette tension, le rassemblement de tous les membres de l’équipe pendant une poignée de secondes, parfois plus ; le relâchement ensuite, l’effervescence, et à nouveau cette extraordinaire mobilisation de tous.
Dans Une année studieuse, à nouveau, la manière d’écrire de Wiazemsky, fine, subtile, épurée, rend poreuse la frontière entre réalité et fiction. Elle évoque des êtres tels que Cocteau, Truffaut, Jeanne Moreau. Plus encore, elle évoque un Godard intime, méconnu, attachant autant qu’agaçant… un Jean-Luc à l’image de ces héros ou de ces auteurs dont on nomme seulement le prénom : Jean-Jacques (Rousseau), Gérard (de Nerval)… Julien (Sorel), Emma (Bovary). L’image publique de Godard s’éloigne et nous ne voyons plus que Jean-Luc :
Il parlait avec finesse de chaque film, et je découvrais à quel point le cinéma était vital pour lui. Après chaque projection, dans un café ou au restaurant, il analysait le talent de tel cinéaste, la beauté de telle actrice. Avant, je me contentais d’apprécier tous les films sans les différencier. Il m’apprit à le faire et cela m’enchanta.
Voilà pour les quelques pistes littéraires, quelques-uns de ces romans qui aiment rêver sur « le ruban de rêves », selon Orson Welles, qu’est le cinéma.
Dans mon prochain article, je parlerai de quelques textes qui évoquent comédiens et réalisateurs à travers les yeux de ceux qui les rêvent le plus ou qui les idéalisent le moins, selon les cas, ceux qui ont déjà fait l’objet d’un article il y a peu, leurs enfants.
D’ici là, j’espère vous avoir donné quelques envies de lectures… Merci à ceux et celles qui m’ont conseillée dans l’élaboration de ces articles !
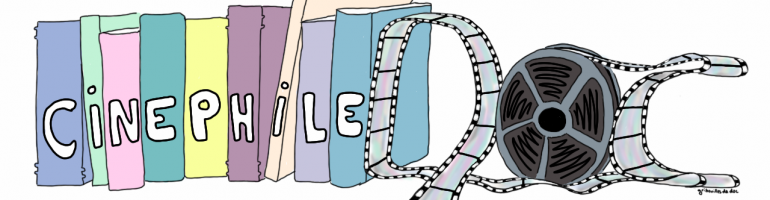







3 Pings