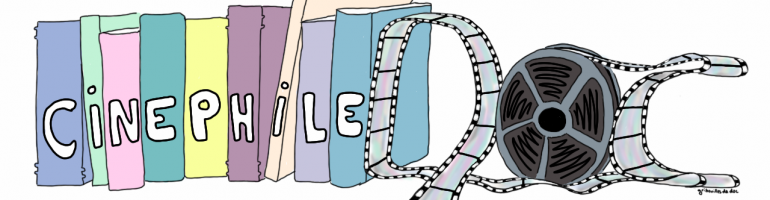Aujourd’hui, pas de chauffage – ou presque pas – au CDI. Si cela m’oblige à garder mon manteau pour travailler, cela n’en éveille pas moins chez moi une pensée réconfortante : les élèves ne viennent pas parce qu’il fait chaud, ils viennent pour le CDI, juste pour le CDI.
Le changement d’heure pendant les vacances a accéléré ces infimes transformations de l’atmosphère qui donnent une impression de flou à tout ce que l’on observe. Je pars, il fait nuit ; je rentre, il fait nuit. Une brume diffuse tombe des réverbères allumés et se disperse des phares des voitures. J’ai l’impression que la journée passe dans un temps infime et presque irréel entre la nuit et le soir. Le ciel est gris, neigeux, et le brouillard se colle aux rues, aux arbres, aux murs, pour faire de nous des myopes éphémères. Quoique, pour moi, la myopie me connaît depuis de nombreuses années.
J’aime le flou sur les choses. Parfois, le flou semble donner au monde qui nous entoure une qualité nouvelle, que la netteté a effacé. Tout se perd, et du coup devient précieux, digne d’intérêt, puisque difficile à saisir. Quand on porte des lunettes, la netteté nous semble presque artificielle, et je recherche les situations où elle m’échappe : des gouttes de pluie, de la buée, ce brouillard matinal, et parfois, au réveil, je repousse le moment de les mettre pour savourer encore un peu l’état de demi sommeil. Le flou démultiplie le réel.
C’est sans doute pour cela que j’aime A la recherche du temps perdu. Chez Proust, le flou acquiert une valeur particulière. Il permet de mieux discerner le réel, de mieux l’apprécier, que l’absolu netteté, qui n’est qu’une imperfection. Voir les êtres avec netteté, c’est voir leurs défauts. Cela empêche de les idéaliser. Contrairement aux impressions fugitives que l’on a des êtres que nous aimons :
« La manière chercheuse, anxieuse, exigeante que nous avons de regarder la personne que nous aimons, notre attente de la parole qui nous donnera ou nous ôtera l’espoir d’un rendez-vous pour le lendemain, et jusqu’à ce que cette parole soit dite, notre imagination alternative, sinon simultanée, de la joie et du désespoir, tout cela rend notre attention en face de l’être aimé trop tremblante pour qu’elle puisse obtenir de lui une image bien nette. Peut-être aussi cette activité de tous les sens à la fois et qui essaye de connaître avec les regards seuls ce qui est au-delà d’eux, est-elle trop indulgente aux mille formes, à toutes les saveurs, aux mouvements de la personne vivante que d’habitude, quand nous n’aimons pas, nous immobilisons. Le modèle chéri, au contraire, bouge ; on n’en a jamais que des photographies manquées. »
Ce qu’apporte Proust à la littérature et au regard, c’est ce bonheur du flou, du manque, de l’impression fugitive, de l’absence. Lorsque les choses s’imposent à nous, elles perdent en valeur. Ce n’est qu’en faisant leur deuil, qu’en leur donnant le verni du souvenir et de l’imagination qu’elles s’embellissent.
C’est aussi pour cette raison que j’aime les films en noir et blanc et ceux qui donnent une certaine place au brouillard. Roland Barthes avait consacré dans ses Mythologies un magnifique article au visage de Greta Garbo :
« Garbo appartient encore à ce moment du cinéma où la saisie du visage humain jetait les foules dans le plus grand trouble, où l’on se perdait littéralement dans une image humaine comme dans un philtre, où le visage constituait une sorte d’état absolu de la chair, que l’on ne pouvait ni atteindre ni abandonner. […] C’est sans doute un admirable visage-objet ; dans La Reine Christine, […] le fard a l’épaisseur neigeuse d’un masque ; ce n’est pas un visage peint, c’est un visage plâtré, défendu par la surface de la couleur et non par ses lignes ; dans toute cette neige à la fois fragile et compacte, les yeux seuls, noirs comme une pulpe bizarre, mais nullement expressifs, sont deux meurtrissures un peu tremblantes. Même dans l’extrême beauté, ce visage non pas dessiné, mais plutôt sculpté dans le lisse et le friable, c’est-à-dire à la fois parfait et éphémère, rejoint la face farineuse de Charlot, ses yeux de végétal sombre, son visage de totem. »
Le noir et blanc donne rétrospectivement aux visages et aux films une autre dimension du réel, où la brume, la fumée, la vapeur, l’ombre et la lumière, la pluie et le mouvement sont des acteurs à part entière (je pense particulièrement à certaines scènes de Rebecca, d’Alfred Hitchcock.
En couleur, parmi les scènes les plus belles des films comme Chantons sous la pluie ou Autant en emporte le vent, il y a ces scènes de pluie, de hangars de studio aux fumées colorées, pour le premier, et le cauchemar de Scarlett, à la poursuite de Rhett dans le brouillard, pour le second. Je ne me souviens pas du dernier film récent qui aurait pu m’apporter le même genre de sensation. Peut-être les scènes de promenades de Lionel Logue et du futur George VI dans les rues de Londres dans Le Discours d’un roi, mais aussi l’univers de Ridley Scott, dans Gladiator et Kingdom of heaven. Certaines scènes de séries comme Mad men ou Game of thrones sont elles aussi voilées par cette atmosphère étrange et dépaysante.
Après tout, voir les choses sous un autre angle, sans la netteté brutale et laide de l’actualité, ce n’est pas seulement prendre de la distance. C’est aussi fermer les yeux, pour se forger son propre regard. On attend de nous un regard critique, quasi exorbité, sur le réel ; on oublie trop souvent maintenant ce « troisième oeil » du rêve et de l’imaginaire qui nous rendrait ce réel moins aveuglant.