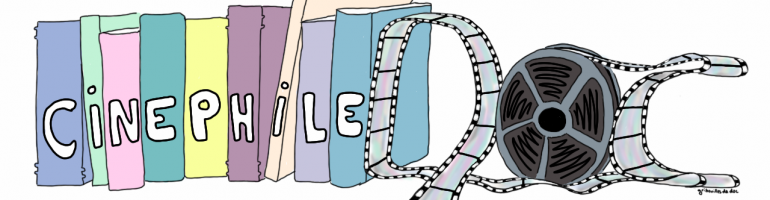Il y a quelques jours, j’ai achevé la lecture du dernier roman de Carlos Ruiz Zafon, Les Lumières de septembre, publié en mars aux éditions Robert Laffont. Dire qu’il s’agit de son dernier roman est une inexactitude. Les Lumières de septembre sont le troisième volet de la Trilogie de la brume, œuvre de jeunesse de l’auteur. Elles font suite au Prince de la brume et au Palais de minuit.
Je me souviendrai toujours de l’instant où j’ai ouvert, sur les conseils d’une amie, L’Ombre du vent, pour la première fois, et où j’y ai lu ces phrases :
« Je me souviens encore de ce petit matin où mon père m’emmena pour la première fois visiter le Cimetière des Livres Oubliés. Nous étions aux premiers jours de l’été 1945, et nous marchions dans les rues d’une Barcelone écrasée sous un ciel de cendre et un soleil fuligineux qui se répandait sur la ville comme une coulée de cuivre liquide. »
Et puis les pages du livre ont défilé entre mes mains, plus vite que je ne l’aurais souhaité, pour me laisser le sentiment d’avoir lu l’une des œuvres qui marquera, et marque peut-être déjà, l’histoire de la littérature. J’ai parlé de ce livre, je l’ai vu dans les mains d’une multitude de personnes, je l’ai offert à la plupart des gens de mon entourage… mais peu à peu son souvenir s’estompe, et je sens que le moment d’une relecture se fait de plus en plus urgent, car lorsque mes « disciples » viennent m’en parler, je ne parviens plus très bien à rentrer dans les détails de ce texte à couper le souffle.
Mais depuis L’Ombre du vent, Carlos Ruiz Zafon est devenu pour moi l’un des auteurs dont je ne tolère qu’à peine la critique, et pour qui justement j’abandonne tout esprit critique. Il y a des œuvres comme ça, livres ou films, pour lesquelles on retrouve un regard d’enfant, et où l’on se laisse guider. Parmi elles, je retrouve pêle-mêle aussi bien la Recherche du temps perdu et les films de Truffaut, les romans de Zafon et de J.K. Rowling (ainsi que leurs adaptations).
L’univers de Zafon est un labyrinthe cathédrale. L’Ombre du vent et Le Jeu de l’ange sont les deux premiers volets d’une tétralogie, celle de ce lieu fascinant et mélancolique que représente le Cimetière des livres oubliés. Indépendamment de cette tétralogie, restent la Trilogie de la brume, et un autre roman isolé, Marina.
Il serait vain de chercher à restituer cet univers, à le résumer. Mais voilà ce à quoi Zafon, à mon sens, veut nous convertir. Les bibliothèques, véritables dédales, où règne un désordre mystérieux et rassurant. Les livres, qui sont souvent presque plus vivants que les personnages (en particulier dans Les Lumières de septembre et dans L’Ombre du vent). Les lieux qui prennent vie. L’ombre qui devient un être à part entière. Il aime les métiers qui sollicitent des compétences mécaniques et qui permettent de créer des objets fabuleux – horlogerie, ingénierie, etc. Il aime les automates et les marionnettes, qui ne sont pas sans rappeler les mythes de Frankenstein et les contes d’Hoffmann, en particulier celui de L’Homme au sable (l’un des personnage des Lumières de septembre s’appelle d’ailleurs Hoffmann). Il aime les personnages maudits par le destin, détruits par des forces diaboliques implacables… fils et filles aussi bien de Faust que de Rebecca (Daphné du Maurier).
Plus que tout, il aime les villes où l’on se perd, les palais qui grandissent comme des plantes, et les livres, véritables mondes dans leurs mondes, que l’on écrit pour mieux perdre le lecteur, et ne lui faire rien aimer de mieux que ce sentiment de vertige.