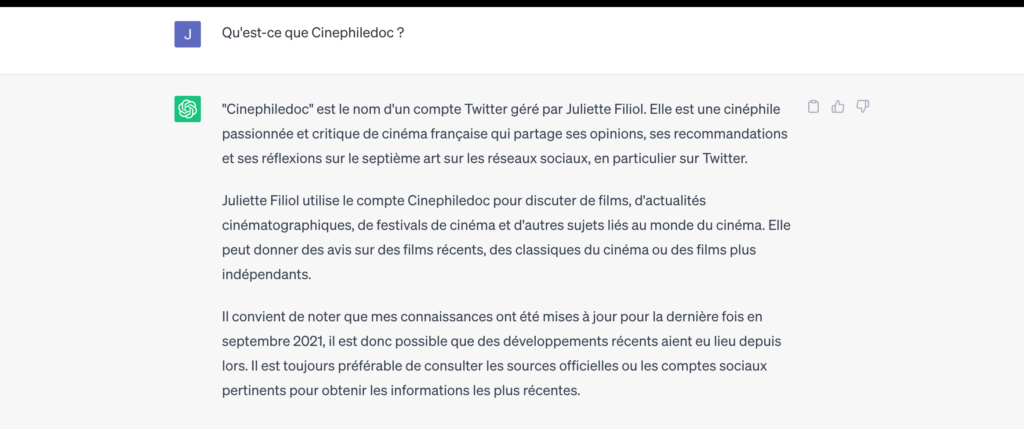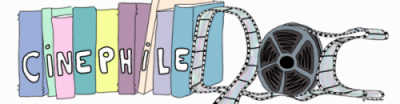À quelques jours de la reprise, je renoue avec une tradition assez ancienne sur ce site, celle de la participation à l’université d’été Ludovia, qui fête cette année sa vingtième édition.
J’ai voulu, pour ce vingtième anniversaire, proposer un petit article, et j’ai fouillé farfouillé dans mes archives sur Cinephiledoc.
J’ai hésité (pas très longtemps) entre la première forme que j’avais choisie : celle de l’abécédaire de ma première participation, en 2015, et celle de l’avant / pendant / après que j’ai utilisée pour deux éditions : en 2016 et en 2017.
Avant donc de parler de Ludovia, et avant de parler de l’avant Ludovia, je me permettrai de faire un petit point sur mes précédentes participations, en remettant les liens des articles qui leur étaient associés.
Avant : éditions précédentes
Sur mon profil LinkedIn, j’ai fait un petit résumé des éditions précédentes, je vais ici le développer un peu plus. Pour ces différentes participations, j’ai eu différentes casquettes.
- 2015 / Ludovia#12 : première participation, la néophyte que j’étais a essayé d’apprivoiser l’événement via un abécédaire dans un article intitulé « À quelques jours de la rentrée ».
Pour cette édition, j’avais déjà la casquette de l’experte numérique, et je venais à Ludovia en compagnie des experts disciplinaires de la DNE.
- 2016 / Ludovia#13 : deuxième participation, toujours casquette DNE, j’inaugure avec cette édition une forme d’article « Avant, pendant, après » avec le défi de compléter en direct mon article au moment du « pendant »
- 2017 / Ludovia#14 : troisième participation, cette fois en tant qu’intervenante pour un explorcamp. Je présente le travail réalisé avec Sandrine Duquenne autour de QR-codes afin de promouvoir la lecture. Je reprends la forme de l’avant / pendant / après. Je repars de Ludovia avec une petite idée qui va faire lentement son chemin dans ma tête : LudoDOC.
- 2018 / Ludovia#15 : pour la première fois, grâce au soutien d’Aurélie Julien et d’Éric Fourcaud, le collectif #LudoDOC organise son premier événement associé, avec entre autres les interventions de Bérengère Stassin qui propose une conférence sur « Cyberharcèlement & EMI », des présentation de Sandrine Geoffroy, Sophie Gronfier et Audey Démonière-Rouvel
Pour l’occasion, est lancé le site LudoDOC, sa chaîne YouTube grâce à laquelle seront réalisées cette année-là des superbes interviews de profs docs et son compte Twitter.
J’ai retrouvé sur mon site le moment Twitter (toujours consultable) de l’édition et je mets ici le lien de la rubrique LudoDOC de l’événement.
À partir de cette année et jusqu’en 2023, je délocalise sur LudoDOC les participations à Ludovia.
- 2019 / Ludovia#16 : nouvel événement associé LudoDOC. Cette fois, on a un beau roll-up bien visible, toujours conservé et convoyé par Bénédicte.

Pour cette édition, nous avons le bonheur d’accueillir une conférence de Stéphanie de Vanssay, des interventions enthousiastes et dynamiques des profs docs de Créteil (même si on mettra du temps à avoir les articles – poke ADR), et de Magalie et Dany qui nous présentent le Défi Babelio.
Cette année-là, je fais le trajet avec Aurélie, une copine du lycée, et nous présentons un escape game qui met en oeuvre une collaboration entre profdoc, SVT et physique-chimie.
Nous organisons un concours de Bookfaces, et nous remportons à la fin de l’édition un prix des blogueurs de l’édition.

J’ai d’ailleurs un petit pincement au coeur car nous devons une partie de ce prix à la lumineuse Caroline, qui s’était prêtée avec humour au concours de bookfaces, et dont l’esprit, je n’en doute pas, accompagnera la vingtième édition de Ludovia…
- 2020 : Ludoviales et Ludovia#17. Deux éditions sous covid, l’une à distance en avril, et l’une en août. Nous nous retrouvons avec Bénédicte pour cette édition masquée et hybride, mais non dépourvue de bonne humeur.
Nous y rencontrons Béatrice et Fabienne, deux nouvelles recrues dont le fourmillement d’idées nourrira par la suite notre site LudoDOC.
En 2021, des contraintes personnelles m’éloignent pour la première fois de Ludovia, en 2022 je sèche (physiquement et intellectuellement) pour l’édition Ludovia#19.

En 2023, Ludovia me rattrape avec sa thématique et, après une conversation téléphonique avec Bénédicte (nos conversations durent généralement au minimum une heure, ce qui s’explique par l’alliance de deux bavardes dont l’une est une prof doc du sud…), nous décidons de soumettre notre candidature à un explorcamp.
Fin mai, nous apprenons que cette candidature est retenue, c’est donc parti pour Ludovia#20 !
Mémo parce que oui, cet article est supposé être structuré…
Et je me rends compte qu’avec cette rétrospective, j’ai été très bavarde, donc voici, cette fois plus rapidement, les préparatifs de l’édition 2023, et un rappel de structure de l’article, façon édition Ludovia#14 :

Dans « Avant », vous retrouverez mon petit programme personnel, les petits points de rendez-vous que je me suis fixée, les explorcamps et tables rondes auxquels je tenterai d’assister (et qui ne correspondent pas toujours à mon formulaire d’inscription, mais l’université étant assez détendue, je ne me fais pas trop de soucis…) mais aussi, pour cette année, l’explorcamp co-animé avec Bénédicte.
Dans « Pendant », vous trouverez des mises à jour de cet article que j’essaierai de faire au fur et à mesure, même si je ne garantis rien.
Enfin, dans « Après », vous trouverez le vendredi ou le lundi suivant Ludovia, des productions, story, cogitations, ressentis, etc.
Donc Ludovia#20… Avant
Mardi 22 août
- J’arrive par le train aux environs de 17h45, en espérant voyager léger et sans retard, mais avec quelques lectures sur l’intelligence artificielle dans mes bagages…

- Il est donc quelque peu ambitieux d’espérer assister à l’ouverture officielle à 18h, mais bon j’aurai peut-être la chance de suivre le premier barcamp sous la halle…
Mercredi 23 août
- Je pensais assister à la conférence de Philippe Meirieu, mais nous avons un premier temps de notre explorcamp pile à ce moment-là avec Bénédicte.
- 9h-9h45 donc : explorcamp avec Bénédicte (première version) « IOUPI est-il le baromètre du bien-être au CDI ? »
- 10h15 : un intitulé bien alléchant « Escape game et compétences psychosociales »
- 14h30 : là encore, décidément j’ai été happée par l’intitulé « Comment redonner aux élèves le plaisir d’apprendre en exploitant leur créativité ? »
- j’ai vu qu’il y avait aussi une rencontre tout l’après-midi sur la thématique du cyberharcèlement donc j’essaierai d’y faire un saut
- il y a aussi l’atelier photo marathon de la copine Bénédicte où je serai une groupie pom pom girl très intériorisée
- j’ai également repéré un explorcamp sur des BD sonores pour lutter contre les discriminations
Comme d’habitude avec Ludovia, le principal regret (et défi) c’est de ne pas avoir le don d’ubiquité…
Jeudi 24 août
- 9h : une table ronde sur les communs numériques à la salle café-musique du casino
- 14h : j’aurai juste le temps d’assister à l’explorcamp de Marie Soulié sur le Paris d’Haussmann revisité !
- 15h : deuxième prise de notre explorcamp avec Bénédicte (et vous pensez que ce sera la même chose mais non)…
- 16h30 : je veux absolument assister à la conférence plénière sur les 19 éditions précédentes de Ludovia !
- 17h30 : j’assisterai à la cérémonie des coups de coeur, parce que c’est un bon moyen de voir tout ce que j’ai loupé en n’ayant pas le don d’ubiquité…
- 19h30 : je garderai encore un peu de sociabilité en réserve pour le dîner de clôture.
Et donc vous voulez voir si j’arrive à tenir ce programme, si je suis bien arrivée, si je n’ai pas oublié mes adaptateurs, ma batterie de secours et tous les documents prévus pour l’explorcamp, même en ayant noté tout ça scrupuleusement dans mon bullet journal ?

Rendez-vous si dessous pour le Pendant et l’Après…
Pendant
22 août : Ludovia, ça se mérite
Et donc, suis-je bien arrivée à Ludovia ? La réponse est oui, et vous pouvez retrouver ma story Ludovia#20 sur Instagram (@juliettefiliol) pour avoir pour en avoir un premier aperçu…
Ça n’a cependant pas été sans mal. Partie de chez moi vers 6h, arrivée pour un TGV en Gare Montparnasse, le dit TGV est parti comme prévu à 9h07, avant de s’arrêter dans le tunnel de Massy pendant une bonne heure, suite à une panne à un poste d’aiguillage.
Première escale surchauffée en gare de Toulouse Matabiau où tout le monde suffoque (36 degrés dans la gare), je repars dans le TER à 15h47. Mais je suis en bonne compagnie puisque je fais connaissance avec Maryline Brosset, TNE 95, et de Florent Nouguez, professeur des écoles à Grigny (nous sommes voisins) et formateur, créateur d’applications, auteur d’un site Classe de Florent, et fan de robots en classe… et qui a dû courir en sortant de la gare à Ax pour une intervention prévue à 18h !

Moi à 18h je n’ai eu le courage que de faire mon inscription, écouter l’ouverture et les mots très touchants d’Aurélie sur Caroline, d’aller déposer mes bagages et de revenir pour un dîner très sympathique en compagnie de ludoviens.

23 août : programme pas tout à fait respecté
Comme je l’avais pressenti, hormis l’explorcamp du matin avec Bénédicte, je n’ai pas vraiment respecté le programme que je m’étais fixé.

Nous avons tenu cet explorcamp à 9h avec Bénédicte, devant des spectatrices rares mais bienveillantes, au moment où Philippe Meirieu faisait salle comble… Les témoignages unanimes m’ont incitée à visionner dès que possible en replay cette conférence, à laquelle je regrette tout de même un tout petit peu de n’avoir pas assisté…
J’ai essayé ensuite de circuler un peu sur les Explorcamps suivants et de glaner de bonnes idées.
J’ai fureté autour du stand Canopé qui rassemble plein de publications alléchantes. J’ai pu croiser Anne Delannoy, que j’ai côtoyée pendant 8 ans avec la DNE en tant que IAN de Toulouse. Puis j’ai retrouvé avec plaisir Véronique Gardair, une des super profdoc de Montpellier, pour le déjeuner.
Nous avons ensuite assisté ensemble à trois présentations :
- celle sur les dérives scolaires de Stéphanie de Vanssay
- une présentation de la fresque des écrans de l’entreprise Colori (avec des cartes qui m’ont à la fois rappelé le jeu S’prit critique & S’team de soi des profs docs de Guyane et l’utilisation du photolangage en formation)
- enfin une proposition de photo marathon par Bénédicte Langlois, qui en plus de fournir des éléments théoriques sur la photographie, nous invitait à un temps de pose / pause pour quelques photos dans Ax-les-Thermes

Enfin, après un verre, j’ai dîné à l’Auzeraie avec Véronique et Denis Tuchais.
Il n’était pas garanti que je poste ce petit compte-rendu ce soir, mais c’est tout de même fait. J’ajouterai les photos en rentrant dans mes pénates, mais vous pouvez d’ores et déjà les retrouver sur mon compte Instagram.
24 août : matinée tranquille, après-midi intense ?
N’ayant pas d’intervention le matin, j’ai profité d’un temps un peu plus relâché que la veille. J’ai pu prendre le temps de papoter avec Béatrice, l’une de nos Ludodoc. Je suis ensuite aller écouter le début de la table ronde animée par Alexis Kauffmann sur les communs numériques et j’ai ensuite glané les dernières minutes de l’Explorcamp de Marie Soulié et Romain Bourdel-Chapuzot sur le bien-être et les classes flexibles.
J’espère que la présentation sera d’ailleurs disponible, parce que je n’ai pu voir que la fin et elle avait l’air incroyable…
L’après-midi, pour être sûre de ne pas le louper, je me suis installée à l’explorcamp de Marie Soulié et David Plumel sur le projet de simulation globale autour du Paris d’Haussmann, et avec les Explorcamps co-animés avec Bénédicte, je dois dire que cela restera un de mes meilleurs souvenirs de cette édition.
Nous avons ensuite co-animé avec Bénédicte la deuxième prise de notre atelier IOUPI, dans une version plus participative que la veille, et nous en publierons très prochainement la restitution.
Mes neurones grillés par le soleil ont eu un petit coup de paresse et mon corps n’a pas réussi à se mouvoir pour la clôture de ce Ludovia, mais je repars comme d’habitude avec le plein d’idées, d’envies et d’énergie, et vous retrouverez très prochainement ci-dessous dans la partie APRÈS, mes notes, les publications et une version de cet article enrichie des photos que j’ai pu prendre.
Après : notes, publications et productions
Inspirations
Comme promis je poste ici les bonnes idées, les liens de ressources que l’on m’a partagés ou les présentations auxquelles j’ai assisté, mais aussi en guise d’aide-mémoire, ce que je dois aller consulter.
- un site partagé dans le TER en allant à Ludovia, qui permet de transformer un dessin en personnage animé
- le replay de la conférence de Philippe Meirieu et sa présentation qu’il a ensuite partagée sur son compte
- l’atelier d’une collègue dont l’explorcamp était sur la table à côté de la nôtre et qui avait l’air vraiment intéressant : une proposition d’escape game en utilisant la programmation Python
- le site Dérives scolaires de Stéphanie de Vanssay qui revient sur toutes les pratiques glissantes auxquelles on assiste dans certains établissements, soi-disant pour favoriser le bien-être
- la fresque des écrans de l’entreprise Colori pour travailler avec les élèves sur l’usage des écrans
- une présentation sur l’intelligence artificielle que plusieurs personnes m’ont signalée
- un parcours EMI « Les veilleurs de l’info » proposé par la ligue de l’enseignement, gratuit et téléchargeable
- les boîtes de jeux Challenge bac proposées par les éditions Belin
- les présentations de Marie Soulié sur ses différents explorcamps
Productions

Je poste ici le lien de la rubrique LudoDOC où serons disponibles notre présentation « IOUPI est-il le baromètre du bien-être au CDI ? » et les productions associées à cet atelier :
- présentation de l’atelier publié sur Ludomag
- support en ligne de l’explorcamp
- productions associées