 « Des milliers sur les routes, les voies ferrées désaffectées, à l’heure où je vous parle, clochards au-dehors, bibliothèques au-dedans. Rien n’a été prémédité. Chacun avait un livre dont il voulait se souvenir, et y a réussi. »
« Des milliers sur les routes, les voies ferrées désaffectées, à l’heure où je vous parle, clochards au-dehors, bibliothèques au-dedans. Rien n’a été prémédité. Chacun avait un livre dont il voulait se souvenir, et y a réussi. »
Au lieu de construire, à la manière de George Orwell dans 1984, un monde où l’histoire se réécrit en permanence, où le service des archives est le domaine de l’imagination, puisqu’il faut sans cesse réinventer le passé pour le conformer à la politique du présent, Ray Bradbury a créé, dans Fahrenheit 451, un avenir qui refuse le passé, et qui se consacre exclusivement à sa destruction. C’est toute la mémoire du monde qui est menacée, et dont les seuls dépositaires deviennent ces « hommes-livres ».
Il m’est impossible de penser à Fahrenheit 451 sans y associer les images du film de François Truffaut, et c’est à chaque fois les deux mêmes scènes qui s’imposent. La première, c’est l’intervention des pompiers incendiaires dans la maison de la vieille dame. Ils y retrouvent l’une des plus imposantes bibliothèques clandestines de la ville. Lorsque les livres sont brûlés, Truffaut filme leur agonie comme s’il s’agissait d’êtres vivants : les pages se tordent de douleur, se convulsent, tremblent sous la flamme, et la femme qui s’immole sur ce bûcher fait de même. Elle ne fait qu’un avec les livres. Elle est le premier livre incarné que rencontre Montag dans sa conversion à la mémoire.
La deuxième scène, c’est la confrontation de Montag avec les hommes-livres. Je ne me souviens plus si dans le livre il y a le même lapsus, ou s’il s’agit d’une idée de Truffaut. En anglais, Montag entend « good people » lorsqu’on lui parle des « book people ». En français, le lapsus est traduit : « hommes libres », « hommes-livres ».
Les « hommes-livres » redonnent vie au livre qu’ils récitent. J’aime ces œuvres où les livres sont plus vivants que les personnages qu’ils côtoient. Dans A la recherche du temps perdu, le livre se confond avec le narrateur, il s’étire pour prendre la mesure de son expérience et de son être. L’auteur aurait-il eu plus de temps, le livre aurait pu croître en conséquence. Le livre à écrire se confond avec la vie passée à l’écrire et avec la vie vécue. Chez Bradbury, l’homme devient le réceptacle du livre et confond sa vie et celle de l’œuvre qu’il choisit. Là encore, cette dernière est à la mesure humaine du temps et de la mémoire, fragile mais investie. Enfin, chez Zafon, dans L’Ombre du vent, dans Le Jeu de l’ange et dans Les Lumières de septembre, le livre est l’incarnation maudite de son auteur. Il se nourrit de l’être, hérite de sa vie et de son souvenir et revient hanter les hommes, tout puissant, rebelle aux prières et aux tentatives de destruction.
Quels hommes-livres serions-nous ? Quels livres voudrions-nous incarner, pour substituer leur mémoire à la nôtre ? Quelle mémoire est assez vivace pour se consacrer exclusivement à un seul livre et ne vivre que pour lui ?
Ray Bradbury est mort mardi.
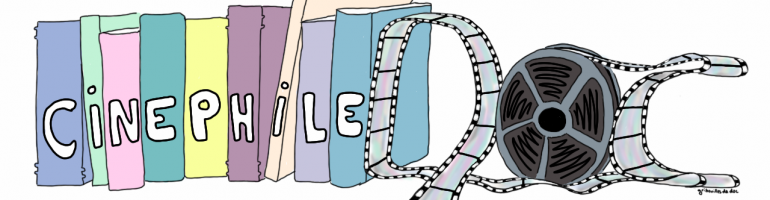



Laisser un commentaire