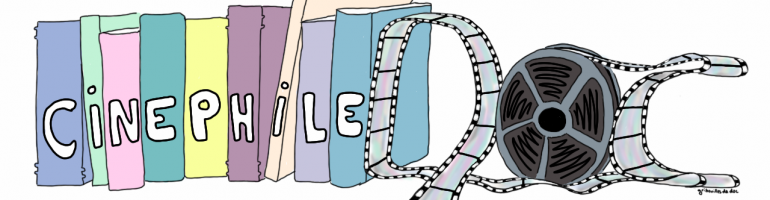En 2013 sortira au cinéma une nouvelle adaptation de Gatsby le Magnifique, le roman de Francis Scott Fitzgerald, près de quarante ans après celle mettant en scène Robert Redford et Mia Farrow. Une version magnifique à tout point de vue. Mais je suis convaincue, ayant en mémoire l’extraordinaire prestation de Leonardo di Caprio dans Aviator, que ce dernier saura parfaitement incarner cet Howard Hughes fictif qu’est Gatsby (la déchéance en moins).
Gatsby fait partie des héros désenchantés et désespérés, à la lisière du cynisme, pour lesquels j’ai toujours eu beaucoup d’affection. Je m’amuse à leur trouver des cousinages, des parentés, des descendances, au gré de mes expériences de lectrice et de spectatrice. Je pourrais d’ailleurs en tracer la chronologie littéraire et cinématographique, qui s’étendrait des années 1920 aux années 1960, mais que l’on serait libre de prolonger à volonté :
En 1925 paraît donc Gatsby le Magnifique, roman emblématique de la « Génération perdue » des années 1920. Ce qui frappe, en tout cas pour moi, c’est moins l’amour destructeur que voue Gatsby à Daisy, dans une atmosphère de frivolité et d’inconscience, que le mystère qu’il incarne. Celui d’un ovni, d’un être complètement déconnecté d’une époque qu’il ne comprend pas plus qu’elle ne le comprend lui-même. Celui d’un météore, à la réputation sulfureuse, recraché vivant par la première guerre mondiale et arrivé là on ne sait comment.
En 1927, Stefan Zweig publie La Confusion des sentiments. Bien que les sentiments y soient tout autant exacerbés, il semble que l’histoire pèse moins sur le destin des personnages, mais on y retrouve une atmosphère brumeuse, dérangeante et contrainte, mêlée cette fois-ci non de frivolité, mais d’une érudition raffinée et mélancolique.
Je saute dix ans… sans doute y’a-t-il d’autres témoignages de ces monstres littéraires.
Je parviens en 1937. Le Voyageur sans bagages, Jean Anouilh. Mêmes souvenirs de la première guerre mondiale. Même personnage recraché vivant par les tranchées : celui de Gaston, soldat amnésique réclamé par plusieurs familles et qui, plutôt que de subir un passé qu’il ne reconnaît plus comme le sien, choisit de s’en approprier un nouveau.
Et puis je retrouve, à la fin des années 30 et au début des années 40, une succession d’œuvres pour lesquelles on a pris l’habitude d’évoquer les héros presque comme des traits de caractères (le petit nom de cette figure de style, c’est l’antonomase), soit que l’œuvre porte elle-même leur nom, soit qu’elle s’efface derrière eux : Roquentin (La Nausée) , Gilles, Aurélien, Meursault (L’Étranger). Et pour chacun, la mélancolie, le cynisme, l’abandon, le désenchantement.
Il ne leur reste plus qu’à survivre à une deuxième guerre et à attendre l’arrivée de leurs descendants cinématographiques… les Michel Poiccard d’A bout de souffle, les Antoine Doinel des Quatre cents coups, les Bertrand Morane, les Julien Davenne, les marginaux, les solitaires, les séducteurs et les enfants…