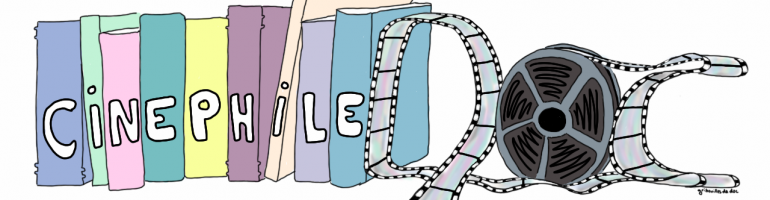Lorsque j’observe la façon dont on utilise l’information, dont on y a accès et dont on la communique, je suis de plus en plus frappée, pas seulement par la rapidité dont on clique d’un lien à un autre – ce que Nicholas Carr rappelle très bien dans son article « Is Google making us stupid ? » (Google nous rend-t-il idiots ?) – mais aussi par la nature même de cette information. L’information que l’on transmet aussi bien que celle que l’on consulte est de plus en plus succincte.
Sur les sites d’actualité, de presse en ligne, à la télévision et même dans les formats papier des journaux, sous forme d’encarts, on l’appelle un « flash ». Sur les mêmes sites d’actualité, que cette actualité soit politique, économique, culturelle, c’est un flux, un fil ou un lien. Sur les réseaux sociaux, c’est un « Like », un « Tag » ou un « Tweet ». Ce n’est pas seulement l’information qui est réduite à son essentiel, c’est le nom qu’on lui donne.
Lorsque l’on tape les premiers mots d’une requête sur Google, les différentes suggestions de réponses à notre demande apparaissent instantanément. Google is suggesting… de plus en plus d’invitations au clic et au butinage. Le butinage, c’est cette pratique que l’on rencontre aussi bien en bibliothèque que dans un magasin de vêtements, et qui consiste à fureter, à s’égarer, à toucher les documents et les livres, et finalement à retrouver l’information que l’on cherchait, ou à trouver justement celle que l’on ne cherchait pas.
Sur Facebook, il n’est même plus besoin d’écrire cette information pour la communiquer : les applications permettent de dire où l’on se trouve, et il suffit d’un clic pour changer de situation sentimentale. Journalistes, sondeurs, et humoristes (notamment la série télévisée Bref) ont étudié la façon dont le statut est révélateur de la personnalité d’un usager de Facebook, depuis le météorologue amateur jusqu’à l’exhibitionniste.
Il y a ceux qui utilisent Facebook pour rapporter les moindres détails de leur journée, ceux qui veulent faire envie en étant un jour aux Etats-Unis, le lendemain en Nouvelle-Zélande, ceux qui cherchent à nous faire passer un message subliminal « Les gens qui…. », « Y’en a marre de ceux qui… », ceux qui tentent de faire dans la philosophie et le concept, et ceux qui traduisent leurs humeurs en citations et paroles de chanson.
Pour moi le statut sur Facebook, et toutes les formes d’informations minimalistes que l’on rencontre maintenant, du tweet au flash en passant par le tag, sont toutes les expressions d’un concentré de présent. Et comme mon esprit tordu fonctionne par associations d’idées, elles me font toujours penser à cette citation de Marcel Proust, dans Le Temps retrouvé :
« Une minute affranchie de l’ordre du temps a recréé en nous pour la sentir l’homme affranchi de l’ordre du temps. »
(Pour les courageux, je recommande d’ailleurs la lecture du très bel article « Proust, l’instant et le sublime » d’Agathe Simon.)
Cette citation de Proust témoigne pour moi de toute l’ambition et de tout l’espoir de ce que nous publions sur Internet : qu’il s’agisse d’un article, d’un commentaire, d’une mise à jour de profil ou d’un tweet, nous tentons de restituer l’instant, de le partager et de le revivre en en retrouvant, sur notre page ou notre « journal », un instantané.