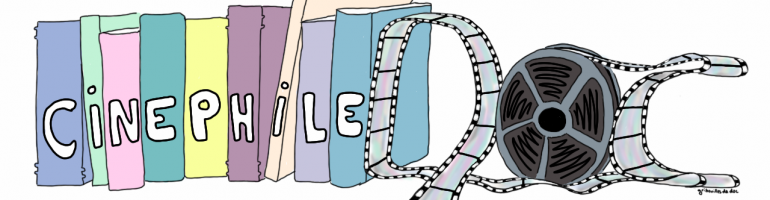Pour un certain nombre de courageux – dont une amie à qui j’adresse tout mon soutien et mes bonnes ondes du moment (ce qui pourrait se traduire par : « Vas-y cocotte, on y croit ») – les deux journées de demain et de mercredi seront consacrées au CAPES de documentation. Deux épreuves de cinq heures pour faire ses preuves.
C’est aussi l’occasion de rappeler que non, le seul concours que passent les professeurs documentalistes n’est pas une course chronométrée que remporte celui ou celle qui couvre un livre le plus rapidement. Lorsque j’ai parlé à une de mes connaissances de mon intention de passer le CAPES, elle m’avait répondu d’un ton méprisant que je n’allais quand même pas « passer ma vie à coller des étiquettes sur des livres ». Mais non, nous ne sommes pas que des manutentionnaires et il ne suffit d’appuyer sur un bouton pour que nous « crachions » des livres.
Lorsque l’on prépare le concours, ou plus exactement lorsque l’on assiste aux premiers cours de préparation, on ne se doute pas de la variété des missions qui sont attendues de nous : gestion d’un centre de documentation, et donc d’un budget, veille culturelle et mise en place de partenariats, organisation de séquences pédagogiques, promotion de la lecture, veille professionnelle, mises à jour des connaissances en matière d’information et publication d’outils en ligne. En gros, on attend l’élaboration d’un projet cohérent permettant de relier toutes ces missions au contexte dans lequel on exerce.
Depuis deux ans, comme pour tous les autres CAPES, la préparation du concours se fait dans le cadre d’un Master des métiers de l’enseignement. L’écrit du CAPES de documentation est composé de deux épreuves :
- une composition à partir d’un texte et portant sur un sujet relevant des sciences de l’information et de la communication ;
- une étude d’un sujet de politique documentaire relative à un établissement scolaire du second degré suivie d’une question se rapportant à l’histoire, aux enjeux et à l’épistémologie de la documentation.
La première épreuve est une sorte de dissertation qui prend appui sur un court texte théorique. A partir de ce texte, on pose une question aux candidats, sur laquelle ils doivent argumenter. Cette composition requiert entre autres des connaissances approfondies bien-sûr en sciences de l’information, sur les penseurs et l’actualité de la diffusion et de la recherche d’informations (Internet, usages individuels et collectifs, réseaux sociaux), sur les différentes formes de pédagogies, et sur l’histoire et l’actualité du métier de documentaliste.
La seconde épreuve est en deux parties. La première partie est une étude sur dossier (composé d’une dizaine de documents). Il s’agit de réfléchir à une question concrète, dans un contexte particulier. Le candidat devra produire un plan de classement et une note de synthèse, qui devront témoigner de ses connaissances sur les dispositifs et l’actualité de l’éducation nationale et les missions du professeur documentaliste. Cependant, à l’intérieur de la note de synthèse, il ne devra pas prendre parti ou commenter les documents. C’est seulement durant la conclusion qu’il pourra approfondir la question et apporter son point de vue personnel sur le sujet. La difficulté tient donc en partie de cette différence de postures : neutralité dans le corps de la note de synthèse, réflexion personnelle dans la conclusion.
La deuxième partie de cette épreuve est une question sur l’histoire, l’évolution et les enjeux propres à un élément des sciences de l’information et de la documentation. Le candidat doit connaitre les grands théoriciens de la documentation, avoir certaines notions de philosophie, de sociologie, de pédagogie, de bibliothéconomie (normes et langages documentaires) et de littérature, savoir définir et comparer les éléments qui composent cette question. En 2011, la question portait sur les classifications décimales. En 2012, sur les dictionnaires et encyclopédies.
Si je reviens deux ans en arrière, voilà ce qui me servait pour préparer les différentes épreuves : les derniers textes et les rapports parus sur la profession ainsi que les plus anciens (rapports Durpaire, PACIFI, circulaire de missions), les textes parus sur le numérique et les pratiques culturelles (publications d’Olivier Donnat, rapport Fourgous). La fréquentation assidue de Savoirs CDI, d’Eduscol, du Café pédagogique. La lecture de quelques incontournables théoriques, de Yves-François le Coadic à Alexandre Serres, mon préféré restant Sciences de l’information et philosophie, de Marie-France Blanquet. Le suivi de quelques blogs (Pascal Duplessis, Olivier Ertzscheid, Olivier Le Deuff, Philippe Watrelot, etc.) de revues et de listes de diffusion professionnelles. Il fallait aussi avoir ne serait-ce qu’une vague idée des dernières évolutions du Web, des langages documentaires (normes, UNIMARC, métadonnées) et des outils de veille et de publication (blogs, forums, réseaux sociaux, portails netvibes, pearltrees…). J’en oublie certainement.
C’est en repensant à tout cela que je tiens à exprimer tous mes encouragements aux candidats de cette session et que j’ajoute juste ceci : « Courage, les amis, c’est bientôt fini ! »